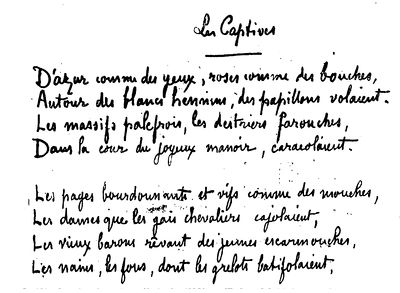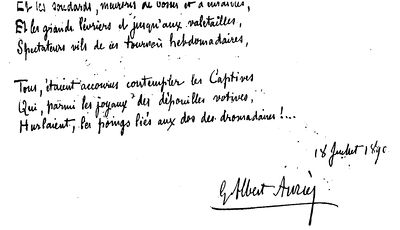De toutes les tâches qui peuvent incomber à
tel, selon les hasards plus ou moins sinistres de
la vie, il n'en est guère d'aussi délicate que celle-ci : juger, un mois après sa mort, un jeune écrivain dont on fut l'ami.
Si l'on se tient dans les termes du strict, si l'on n'additionne que des résultats évidents: on risque, en voulant être trop juste, d'être trop dur; en
voulant être trop vrai, d'être trop sec ; en se bornant
au fait visible par tous, de s'enfermer dans
une littéralité trop discrète et même fausse.
D'autre part, si l'on ouvre l'oreille au conditionnel passé, si l'on soumet à la même opération
arithmétique les dons et les promesses, il est à
craindre que des envieux, un peu bornés, mais
d'autant plus influents sur la foule de leurs pareils,
ne contestent la légitimité du total.
Malgré ce dernier inconvénient, peu grave au
fond, j'essaierai de dire ce qu'Aurier a été et aussi
ce qu'il aurait dû être, en l'accomplissement de sa
vie, suivant la logique des choses et suivant la
logique de son talent.
Avec un tempérament outrancier d'observateur
ironiste, une tendance à des jovialités rabelaisiennes, Aurier se trouva, dès ses premières
années d'étudiant, engrené dans un mouvement
littéraire en apparence très opposé à ses penchants. Il voyait loin, déjà, et de haut, parmi une
série de poètes fantoches, myopes et criards;
par laisser-faire, par paresse de les mépriser, il
voulut bien être leur dupe et, plus décadent que
l'intelligence de M. Baju ne pouvait le concevoir,
il leur récita des vers où nul ne soupçonna la parodie, vers « pourris » qui sortaient du cerveau
le plus sain et le plus conscient. Mais, de même
que tout n'était pas ridicule dans le Décadent,
tout n'est pas de pure fumisterie dans les vers
qu'Aurier y donnait abondamment; ce sonnet,
Sous Bois, daté de Luchon, août 1886, n'a pas
qu'une valeur de précocité:
Les forêts de sapins semblent des cathédrales
Qu'ombrent d'immenses deuils. Infinis, sans espoir,
Montent les noirs piliers se perdant en le noir,
Et l'ombre bleue emplit les voûtes colossales !...
Tandis que, pour voiler l'invisible ostensoir,
Pendent sur les vitraux des loques sépulcrales,
Vagues, passent des chants tristes comme des râles,
Les chants de la forêt à la brise du soir.
— O Temple! Bien souvent je suis le labyrinthe
De tes nefs, par la nuit cherchant ton Arche-Sainte!...
Mais, en vain! L'horizon, toujours sombre et béant,
Fuit devant moi ; le Vide dort au fond des salles!
— Ainsi, mon cœur, sondant les célestes dédales,
Marche, toujours heurtant l'implacable néant! (1)
Si, après cette estampe romantique, j'extrais du
même recueil la Contemplation, on aura peut-être
une idée assez juste d'Aurier très jeune, partagé
entre le vouloir d'être sérieux et 1'amusement de
ne pas l'être:
Le cœur inondé d'une ineffable tristesse,
Je contemple le crâne aimé de ma maîtresse.
Dans ses orbites creux, d'épouvantes remplis,
J'ai fait coller deux très beaux lapis-lazulis;
J'ai mis artistement sur l'os blanc de sa nuque,
Poli comme un ivoire, une vieille perruque;
J'ai, dans ce faux chignon, répandu ses parfums
Préférés (souvenir de mes amours défunts);
J'ai placé, pour cacher son rictus trop morose,
A ses troublantes dents ma cigarette rose.
Puis j'ai posé le tout (à la place d'un saint)
Dans une niche, sur les velours d'un coussin.
Et je songe qu'ainsi (méditations mornes!)
La Catin ne peut plus me gratifier de cornes ! (2)
Ces deux notes, l'une de mélancolie, l'autre
d'ironie, persistèrent à sonner jusqu'à la fin dans
les vers d'Aurier, et on les retrouvera dans le
Pendu (3) et dans Irénée (4).
Quant aux caractères propres, différentiels, de
sa poésie, ce sont, il me semble, la spontanéité
et l'inattendu. Il ne fut jamais un chercheur de
pierres précieuses: il sertissait celles qu'il avait
sous la main, plus soucieux de leur mise en valeur
que de leur rareté ; mais, pêcheur de perles,
il le fut aussi trop peu et, trop confiant en sa
force improvisatrice, il laissa, même en des morceaux
jugés par lui définitifs, échapper des à peu
près et des erreurs. Cela vaut-il mieux que d'être
trop parfait ? Oui, quand la perfection de la forme
n'est que le résultat d'un pénible limage, d'une
quête aveugle des raretés éparses dans les dictionnaires, d'un effort naïf à tirer, sur le vide
d'une œuvre, un rideau constellé de fausses émeraudes
et de rubis inanes. Il est cependant une certaine dextérité manuelle qu'il faut posséder; il
faut être à la fois l'artisan et l'artiste, manier le
ciseau et l'ébauchoir, et que la main qui a dessiné
les rinceaux puisse les marteler sur l'enclume.
Mais là, Aurier pécha moins par omission que
par jeunesse, et s'il montra un talent moins sûr
que son intelligence, c'est que toutes les facultés
de l'âme n'atteignent pas à la même heure leur
complet développement ; chez lui, l'intelligence
avait fleuri la première et attiré à soi la meilleure
partie de la sève.
L'intelligence et le talent, voilà, je crois, une
distinction qui n'a guère jamais été faite en critique littéraire; elle est pourtant capitale. Il
n'y a pas un rapport constant ni même un rapport
logique entre ces deux manières d'être ; on peut
être fort intelligent et n'avoir aucun talent ; on
peut être doué d'un talent littéraire ou artistique
évident et n'être qu'un sot; on peut aussi cumuler
ces deux dons : alors on est Gœthe ou Villiers
de l'Isle-Adam, ou moins, mais un être complet.
Aurier manqua de quelques années pour s'harmoniser définitivement. Il en était encore à la
période où l'on ressent une si grande tendresse
pour toutes ses idées qu'on se hâte de les revêtir,
même d'étoffes un peu frustes, de peur qu'elles
n'aient froid dans la chemise aux notules:
d'ailleurs, presque rien de ce que nous connaissons
de lui, en fait de vers, n'avait reçu la suprême
correction.
Mais que l'on ne prenne pas cette opinion
pour absolue; sans parler de quantité de vers
inédits que j'ignore encore, je connais d'Aurier
des poésies très pures et d'art complet. Quelle
objection, par exemple, contre le Subtil Empereur?
Le voici:
En l'or constellé des barbares dalmatiques,
La peau fardée et les cheveux teints d'incarnat,
Je trône, contempteur des nudités attiques
Dans la peau royale où mon rêve s'incarna...
Je regarde en raillant agoniser l'empire
Dans les rires du cirque et les cris des jockeys,
Et cet écroulement formidable m'inspire
Des vers subtils fleuris de vocables coquets !...
Je suis le Basileus dilettante et farouche!
Ma cathèdre est d'or pur sous un dais de tabis...
Quand je parle, on dirait qu'il tombe de ma bouche
Des anges, des saphirs, des fleurs et des rubis ..(5)
Et quelle objection contre le Sarcophage vif? (6)
Cette ironie n'est-elle pas sertie dans l'or des
rimes les plus sûres et rythmée merveilleusement ?
Il reste seulement certain que, de même
que tous les esprits très féconds, Aurier était un
poète inégal. Ce défaut n'est-il point une quasi
supériorité ? Encore une fois,je ne dirai pas non.
Entre ces ébauches, la plus notable, par l'importance
qu'elle devait avoir, semble être Irénée. Il
n'écrivit qu'un acte à peine de cette tragi-comédie
où il voulait expliquer non pas seulement
l'inutilité, mais la nocuité de l'expérience et du
savoir humains ; ce peu est déjà d'un grand
intérêt: on y sent une réelle force de pensée et,
dans tels passages, celui des femmes de jadis, par
exemple, celui où sont dits les méfaits de la
science, il y a des vers exquis ou formidables.
Irénée, l'Innocence, est sollicité par le démon
Asmodeus qui veut lui apprendre la science,
c'est-à-dire l'amour— puisque tout est dans ce mot et que la science n'est que désir, c'est-à-dire amour (7).
« Viens, dit Asmodeus.
« Non ! Viens ! Mes lèvres ont le goût des ambroisies. »
L'Archange qui veille sur le frêle Irénée répond
(je cite d'après un premier texte modifié dans le
dernier manuscrit):
« Le savoir est un puits aux murailles moisies. »
Asmodeus:
« Le savoir est un ciel d'éternel germinal.»
Tel est le débat, entremêlé d'aristophanesques
bouffonneries. Irénée succombe, et, dès qu'il est savant, « la nature lui paraît abominable », (8).
Fâcheusement, l'éducation classique, la lecture,
souvent maladroite, des tragédies de la belle
époque, de séculaires préjugés, la routine où,
depuis la Renaissance, les professeurs de belles-
lettres se suivent à la queue-leu-leu, une grande
paresse d'esprit, enfin, nous font croire que les
personnages des temps historiques s'exprimaient
avec la même gravité pompeuse que la Rodogune
de Corneille ou la Mérope de Voltaire ; on
ne fera jamais admettre à un homme sérieux et
instruit que César Auguste ait jamais pu appeler
sa femme : « mon petit cœur », ou « mon petit
œil », ocellus; ces mots-là et d'autres ont dû
être inventés par les Jésuites quand ils faisaient
des vaudevilles — en latin ! Aurier n'avait point
de telles créances, un peu naïves, et dans Irénée
il mêle toutes les époques et tous les mythes, il
pratique bravement ce que les critiques appelent l'anachronisme, — comme si, pour un poète ou
un écrivain idéaliste, il y avait des chronologies,
— comme si, depuis « les temps les plus reculés »,
aucun document eût jamais pu faire supposer au
plus féroce érudit que les cellules du cerveau
humain vibraient il y a six mille ans autrement qu'aujourd'hui.
Disons plutôt que tout se passe dans le rêve —
et que le Rêve est toujours identique à lui-même,
et que Gauguin ne s'est pas ridiculisé autant que
le croient des sages en introduisant « des coiffes
et des fichus de Ploërmel, des Bretonnes, et de
cette fin de siècle » (9), dans un tableau qui s'intitulera Lutte de Jacob avec l'Ange, — et qu'Irénée
a le droit de converser avec un archange,
même en un temps où les Dominations sont
muettes.
Poète, Aurier l'est encore jusqu'en sa critique
d'art. Il interprète les œuvres, il en rédige le commentaire,— esthète, peut-être, mais non pas
esthéticien, et la valeur de sa critique, presque
toujours positive, tient en partie au choix qu'il
sut faire, de main sûre, entre les artistes et entre les œuvres.
Sa critique est positive; il exalte le sujet de son
analyse; il dit les signifiances obscurément voulues
par le peintre et, ce disant, recompose très
souvent une œuvre un peu différente, par les tendances nouvelles qu'il y trouve, de celle qu'il a
eue sous les yeux : ainsi, dans son étude sur Henry
de Groux (10), un grandiose pendu nous apparaît,
plus grandiose encore et plus lamentable aussi, parmi le renouveau luxuriant des sèves,
que le grandiose et lamentable bonhomme du
peintre de la Violence.
Quant aux défauts des œuvres qu'il aimait, il
les voyait bien, mais il préféra souvent les taire,
sachant que l'éloge doit, pour porter, être un
peu partial, et sachant aussi que le rôle du critique
est de nous signaler des beautés et des joies,
non des imperfections et des causes de tristesse.
A l'œuvre mauvaise, médiocre ou nulle, le silence
seul convient, et, contrairement à l'opinion d'Edgar
Poe, j'affirme que la plupart des chefs-d'œuvre
même ont besoin pour être compris, à l'heure
où ils éclosent, de la charitable glose d'une intelligence amie. Malheureusement, la critique influente,
si peu qu'elle le soit encore, étant devenue
ou vénale ou inepte, ou les deux tout a la fois,
il est nécessaire de la contredire de temps à autre,
rien que pour montrer que l'on n'est pas dupe:
cela seul induisit Aurier à démolir Meissonier (11),
ce badigeonneur ignare au millimètre carré. Cela
fut inutile, comme est toujours inutile la critique
négative: la fièvre amoureuse des foules ne se
guérit pas avec dix pages de sulfate de quinine;
il en faudrait des hymalayas de tomes, — et encore!
L'homme qui peint des états-majors ou des
cuirassiers, comme celui qui narre les faiblesses
de cœur des ingénieurs de l'Etat, enlève naturellement
« tous les suffrages », car dans le bas esclavage
moral où nous croupissons, peuple gâteux,
deux choses seules sont estimées par le public, —
je ne parle pas de l'argent, — le galon et le
diplôme.
Mais ce ne fut que par occasion qu'Aurier livra bataille au taureau; il avait, comme critique,
une besogne plus urgente : mettre en lumière les
« isolés », comme il disait, forcer vers eux l'attention
de quelques uns. La première étude de ce
genre, son Van Gogh (12), eut un succès inattendu;
elle était excellente, d'ailleurs, disait la vérité sans ménagements pour l'opinion, et vantait le peintre
du soleil et des soleils sans ces emballements
puérils qui sont la tare de l'enthousiasme. Dès
là, il exprimait les deux inquiétudes dont il se
souciait avant tout : le peintre est-il sincère? et
que signifie sa peinture? La sincérité, en art, est
bien difficile à démêler de l'inconsciente fraude
où se laissent aller les artistes les plus purs et les
plus désintéressés; l'extrême talent dégénère très
souvent en virtuosité : il faut donc, en principe,
croire l'artiste sur sa parole, sur son œuvre. A la
seconde question, la réponse est généralement
plus facile. Voici ce qu'Aurier dit à propos de
Van Gogh (13), et cela peut servir de définition
assez nette du symbolisme en art:
« C'est, presque toujours, un symboliste. Non point, je le sais, un symboliste à la manière des Primitifs Italiens, ces mystiques qui éprouvaient à peine le
besoin de désimmatérialiser leurs rêves, mais un
symboliste sentant la continuelle nécessité de revêtir ses idées de formes précises, pondérables, tangibles, d'enveloppes intensément charnelles et matérielles. Dans presque toutes ses toiles, sous cette enveloppe morphique, sous cette chair très chair, sous cette matière
très matière, gît, pour l'esprit qui sait l'y voir, une pensée, une Idée, et cette Idée, essentiel substratum
de l'Œuvre, en est, en même temps, la cause efficiente
et finale. Quant aux brillantes et éclatantes symphonies
de couleurs et de lignes, quelle que soit leur importance pour le peintre, elles ne sont dans son travail
que de simples procédés de symbolisation. »
En son étude sur Gauguin (14), un an plus tard, il
revint sur cette théorie, la développa, exposant,
avec une grande sûreté de logique, les principes
élémentaires de l'art symboliste ou idéiste, qu'il résume ainsi:
L'œuvre d'art devra être:
« 1° Idéiste, puisque son idéal unique sera l'expression
de l'Idée;
« 2° Symboliste, puisqu'elle exprimera cette idée
par des formes;
« 3° Synthétique, puisqu'elle écrira ces formes, ces
signes, selon un mode de compréhension générale;
« 4° Subjective, puisque l'objet n'y sera jamais considéré
en tant qu'objet, mais en tant que signe d'idée
perçu par le sujet;
« 5° (C'est une conséquence) Décorative — car la
peinture décorative proprement dite, telle que l'ont
comprise les Egyptiens, très probablement les Grecs
et les Primitifs, n'est rien autre chose qu'une manifestation d'art à la fois subjectif, synthétique, symboliste
et idéiste » (15).
Après avoir ajouté que l'art décoratif est le
seul art, que « la peinture n'a pu être créée que
pour décorer de pensées, de rêves et d'idées les
murales banalités des édifices humains », il impose
encore à l'artiste le nécessaire don d'émotivité,
en alléguant, seule, « cette transcendantale
émotivité, si grande et si précieuse, qui fait
frissonner l'âme devant le drame ondoyant des
abstractions ».
« Grâce à ce don, les symboles, c'est-à-dire les Idées,
surgissent des ténèbres, s'animent, se mettent à vivre d'une vie qui n'est plus notre vie contingente et relative, d'une vie éblouissante qui est la vie essentielle, la vie de l'Art, l'être de l'Etre
.
« Grâce à ce don, l'art est complet, parfait, absolu, existe enfin.»
Sans doute, tout cela est plutôt, au fond, une philosophie qu'une théorie de l'art, et je me méfierais de l'artiste, même supérieurement doué, qui s'appliquerait à la réaliser par des œuvres ; mais c'est une philosophie très haute et possiblement féconde : quelques artistes en seront peut-être touchés même à travers leur cuirasse d'inconscience.
En critique, Aurier était encore d'avis que l'on doit examiner l'œuvre en soi et qu'il est ridicule de faire intervenir dans son jugement des motifs aussi vagues et aussi trompeurs que l'hérédité et le milieu (16). Il y a un lien de cause à effet, cela est naïvement clair, entre l'homme et l'œuvre, mais de quel intérêt peut bien être la connaissance de l'homme pour qui s'amuse aux fantastiques marines de Claude Lorrain ? La logique, si j'y réfléchissais, m'affirmerait ce Claude Napolitain ou Vénitien, Méridional tout au moins, et qu'il soit né en Lorraine, cela me suffoquerait, si j'étais M. Taine ; l'histoire, il est vrai, m'apprend qu'il séjourna à Naples et qu'il passa par Venise: je m'en doutais, mais cela n'ajoute rien à mon rêve, et Cléopâtre, appuyée à l'épaule de Dellius, n'y puise pas une beauté nouvelle.
La critique d'art d'Aurier était fort appréciée ; on sentait la force de son originalité, et, dans le monde où l'on aime et où l'on comprend la peinture impressionniste-symboliste, elle faisait autorité,— monde nouveau et restreint, mais fort et qui peu à peu rejette dans l'ombre des vaines académies le monde ancien des copistes désespérés.
Sans être un bon roman, ni de bonne littérature, Vieux (17) est un roman amusant, et, avec cela, bien ordonné. La personnalité d'Aurier n'y est pas encore bien nette ; son esprit ne s'y affirme qu'à l'état de collaborateur, — collaborateur de Scarron et de Théophile Gautier, de Balzac et même de certains petits naturalistes qui tentèrent d'être goguenards. Mais le plus grave défaut de ce livre fut qu'il n'exprimait plus, quand il fut achevé, les tendances esthétiques de l'auteur, ou qu'il n'en exprimait que la moitié et la partie la moins neuve et la plus caduque. Qu'on lise, cependant, le chapitre VII : ce sont de fort belles pages et bien à leur place, quoique d'un ton plus élevé que le reste du roman ; qu'on lise, au chapitre XXI, la psychologie de l'« heure du coucher » et ce qui suit :c'est d'une finesse un peu simple, mais comme c'est observé et quelle belle ironie en action ! Qu'on lise encore la déclaration d'amour du vieux Godeau, les tendres paroles dont se soulage le malheureux pendant que la bien-aimée se livre, cyniquement, à d'autres soulagements : c'est d'un genre de comique qui n'a de vulgaire que la forme, et qui laisse dans le souvenir une impression de rabelaisianisme quasi grandiose.
Enfin, Vieux est une œuvre très imparfaite, — mais non pas médiocre.
Aurier annonçait plusieurs romans, Les Manigances, La Bête qui meurt : comme toujours, et comme tous les faiseurs de projets, il se préoccupa de réaliser ses promesses dans l'ordre inverse où il les avait faites. On a retrouvé dans ses papiers un manuscrit intitulé Edwige, mais qu'il avait verbalement débaptisé quelques semaines avant sa mort; il sera publié sous ce titre: Ailleurs (18).
C'est plus qu'une esquisse et moins qu'une œuvre
achevée, mais, tel quel, ce petit roman philosophique me semble d'une importance évidente. La fantaisie et l'ironie s'y dressent en des proportions d'épopée: c'est un duel tragi-comique entre la Science et la Poésie, entre l'Idéalité et le Positivisme, conté en un style adéquat au sujet, tantôt bizarrement familier, tantôt mesuré et stellé de belles métaphores. On y retrouvera l'auteur de Vieux, mais plus sobre ; on y retrouvera le poète et le critique d'art, mais plus sûr de sa philosophie et plus maître de l'expression de ses idées ou de ses sentiments.
Aurier avait, comme romancier, un don assez rare et sans lequel le meilleur roman n'est qu'un recueil de morceaux choisis: il savait ériger en vie un personnage, lui attribuer un caractère absolu et dévoiler logiquement, au cours d'un volume, les phases de ce caractère, non par de vagues analyses, mais par la mise en scène de faits systématiquement choisis pour leur valeur révélatrice: tel, dans Vieux, M. Godeau ; tels, dans Ailleurs, Hans et l'Ingénieur. Cet ingénieur est une merveilleuse caricature : Aurier lui prête des propos d'un comique vraiment énorme et pourtant lamentablement vraisemblables, car, c'est encore un autre de ses dons, comme romancier, de n'outrer jamais que le vrai ou le possible: il y avait en lui le génie d'un Daumier,— et Daumier, seul, aurait pu conter avec des images un symbolique épisode aussi amèrement comique que la colère du Dr Cocon accusé d'héroïsme.
Aurier serait allé très loin en ce genre, le roman de l'ironie comique, de l'amertume exhilarante: que de joies il nous eût données ! Là encore, il ne sera pas remplacé : sa mort aura fait dans la Littérature un trou qui demeurera toujours béant.
D'un autre roman qui devait s'appeler le Pandaemonium philosophal, il a été écrit un fragment de plan fort curieux, que voici :
Ch. I. — Hans sortant vers 5 heures d'un café du boulevard a, pour la première fois, la vision du boulevard (houle d'acéphales ventrus, promenade de dos courbes fouaillés, vices sans grandeur, stupidité, banalité, matérialité). Ecœuré, pleurant presque de dégoût, il éructe vers cette foule, indigne de ce haut hommage, le mot sublime, le mot héroïque qui ne devrait plus être prononcé que dans des Panthéons, par de glorieuses prêtresses, depuis que Cambronne le nimba des flambois de la légende
Ch. II. — Rentré chez lui, il soliloque sa haine et son dégoût contre la société moderne, lorsqu'une voix objecte un:
— Mais cependant...
Rendu quasi-fou furieux par cette stupide et imprévue objection, il se précipite pour étrangler l'invisible interrupteur, hurlant:
— Tai toi, Kakégo ! Stupide Kakégo !.. Je vais bien renfoncer tes basses inepties dans ton ventre en te serrant la gorge.
Ce nom barbare de Kakégo (19) lui était venu à la bouche naturellement, comme le nom bien connu d'un familier.
Les mains déjà crispées pour la strangulation du mystérieux interrupteur, n'ayant rencontré que le vide, il se remit vite, disant:
— Enfin ! Qu'importe ! Maintenant, je te connais, toi, mon ennemi toujours cramponné à mes basques quand je veux sauter dans une étoile. Je te connais et je sais ton nom et je te vois malgré ton don d'invisibilité, gros joufflu imbécile, ventre d'hippopotame trimballé par des jambes de basset. Je te vois et c'est pourquoi je te crains moins, et pour te le démontrer je veux dorénavant discuter à loisir avec toi toutes les questions ès-quelles tu as pris la douce habitude de me contrecarrer.
— Soit ! répondit Kakégo entre deux rots satisfaits.
Ch. III. — Ils discutent les causes déterminantes de l'abjection de la société contemporaine.
Ce qui distingue l'homme de la bête, c'est la faculté de se guider sur des entités abstraites, immatérielles, idéales : ex la religion, la morale, la métaphysique;
l'art de la bête, elle, ne se guide que d'après ses besoins matériels.
La société contemporaine repose sur une philosophie qui a mis à se constituer du XVIe au XIXe siècle, et qui est la négation pure et simple de toutes les entités abstraites précitées et le perfectionnement logique de tous les besoins matériels.
L'homme qui subit son influence devient donc une bête perfectionnée — une bête parce que son seul but est l'assouvissement de ses besoins matériels — perfectionnée parce qu'il croit à la grandeur de cette basse religion et qu'il met tout en œuvre pour ce culte abject.
Chapitre des femmes
— Nous faisons, en somme, un roman psychologique.
— Il n'y a pas de roman sans femme, de même qu'il n'y a pas de vie sans femme.
Kakégo.— Tu crois à la femme, toi, l'idéaliste, à la femme, latrine de toute impureté et de toute laideur; tu ne les as donc jamais regardées ?
Hans. — Jamais avec mes yeux, mais souvent avec mes rêves.
Kakégo.— Je vais te les montrer, ça te dégoûtera peut-être, et, d'autre part, puisqu'il faut absolument une femme dans un roman, je vais, d'un coup, en faire entrer un millier dans le nôtre.
Il se met à la fenêtre et se met à jongler avec des louis d'or en chantant d'un air distrait:
Holà ! Là-bas! Les belles qui passez
A pas pressés,
Qui troussez tout en traversant les ponts
Vos clairs jupons,
Vos tendres yeux sont-ils pas éblouis
Par ces louis
Qui dansent, gais, dorés, entre mes doigts
Et qu'on vous doit?
La fortune est en haut de l'escalier,
Sur le palier
Montez ! Montez ! Toutes! Frappez ! Sonnez!
Carillonnez!
Montez causer de finance avec nous
Sur nos genoux.
Occasion rare, sans grands ébats,
D'emplir vos bas !...
Cette romance lointainement sentimentale agit avec la précision d'une formule de goétie. Des coups de sonnette retentirent, la porte s'ouvrit, une femme
parut, puis une autre, puis dis autres, puis bientôt mille.
Examen individuel de chacune. Kakégo met en saillie les défauts physiques ou intellectuels, mais surtout physiques.
A la fin, Hans déclare qu'il n'a pourtant rien vu, et que la plus laide et la plus répugnante deviendra pour lui une Juliette ou une Desdemona, s'il daigne la baigner des encens de son amour.
Ces notes semblent avoir quelque rapport avec Ailleurs; il est assez probable qu’Ailleurs n'est qu'un rejeton du Pandaemonium, une idée seconde qu'il aura plu à l'auteur de traiter avant l'idée mère ; mais, du moins, il sera prouvé que ce Pandaemonium préoccupait sérieusement Aurier et que c'était autre chose qu'un titre destiné à effarer les curiosités.
Que cette brève et maladroite et incomplète étude suffise pour le moment. Ecrite avec des souvenirs plutôt qu'avec des documents, elle ne saurait être qu'un travail de bonne volonté : quand l'œuvre d'Aurier sera totalement imprimée, alors seulement une définitive appréciation pourra être donnée.
Mais j'affirme que nous avons perdu un homme de talent et d'un talent peu ordinaire, un esprit supérieur, un de ces êtres qui sont les Princes du rêve et qui devraient être les Princes de la Vie. « O Mors surda prius !... » dit Prudence. Sourde, elle l'est redevenue, à tout jamais.
le 13 Novembre.
Remy de Gourmont
(1) Le Décadent, 4 sept. 1886.
(2) Le Décadent, 12 juin 1886.
(3) Mercure de France, novembre 1892.
(4) Essais d'Art Libre, novembre 1892.
(5) Mercure, avril 1891.
(6) Mercure, mai 1891.
(7) Joseph de Maistre, Examen de la philosophie de Bacon.
(8) Essais d'Art Libre, novembre 1892, note additionnelle à Irénée.
(9) G.-Albert Aurier, Paul Gauguin (Mercure de France, mars 1891.)
(10) Mercure, oct. 1891
(11) Revue Indépendante
(12) Mercure de France. janvier 1890.
(13) Ibid.
(14) Le Symbolisme en peinture. Paul Gauguin (Mercure de France, mars 1891 )
(15) Aurier détourne un peu de sa signification la plus ordinaire dans ces deux derniers paragraphes le mot subjectif. Il faut se reporter à la définition qu'il en donne (§ 4), et ne pas être tenté de croire que l'art décoratif des anciens Egyptiens ou Grecs ait été subjectif, au sens de personnel.
(16) Voir plus loin l'étude d'Aurier intitulée: Préface pour un Livre de Critique d'Art.
(17) 1891, chez Savine.
(18) Dans le volume d'Œuvres posthumes en préparation.
(19) Littéralement : le Mauvais Moi. — R. G.
Sauf la critique des quotidiens, qui est moins une critique qu'un compte-rendu, la critique du siècle a eu la prétention d'être scientifique.
Ç'aura été le propre du XIXe siècle de vouloir introduire la science partout, même dans les choses où elle a le moins affaire ; — et quand je dis :« la science », il ne faut point entendre la mathématique, la seule science à proprement parler, mais bien ces bâtardes obtuses de la science, les sciences naturelles.
Or, les sciences naturelles, ou sciences inexactes, par opposition aux sciences rationnelles ou exactes, étant, par définition, insusceptibles de solutions absolues, conduisent fatalement au scepticisme et à la peur de la pensée.
Il faut donc les accuser, elles, de nous avoir fait cette société sans foi, terre à terre, incapable de ces mille manifestations intellectuelles ou sentimentales qu'on pourrait classer sous le nom de dévouement.
Elles sont donc responsables — Schiller l'avait constaté (2) — de la pauvreté de notre art, auquel
elles ont fixé pour unique domaine l'imitation, seul but constatable par les.procédés expérimentaux. Donner à l'art ce but, contradictoire de l'art même, n'est-ce point le supprimer purement et simplement ? C'est ce qui est advenu, sauf pour les rares artistes qui ont eu la force de s'isoler loin de ces milieux d'idées dissolvantes.
Ceci constaté, ne serait-il point temps de réagir, de chasser « l'intruse de la maison », comme dit Verlaine, la science, « l'assassin de l'oraison », et de renfermer, si c'est encore possible, les savants envahissants dans leur laboratoire?
Pour ce qui est de la critique, voyons donc d'abord en quoi consiste cette fameuse méthode de la critique scientifique dont on a fait tant de bruit, et essayons d'en montrer la vanité et les illogismes.
Trois hommes la représentent, trois hommes d'une haute valeur, d'une grande intelligence, mais dont le rôle fut si néfaste sur l'art contemporain qu'on doit, en toute justice, leur implacablement refuser la moindre admiration.
M. H. Taine, le théoricien de la méthode, esprit logique, paradoxal et entêté; Sainte-Beuve, qui gâta ses qualités de finesse et de goût en se satisfaisant d'insipides racontars de portière sur les arrière-petits cousins des poètes dont il fallait parler des œuvres; Emile Hennequin, esprit profond et serré, mort trop jeune pour avoir laissé l'œuvre qu'on était en droit d'attendre, mais qui eut pourtant une influence considérable sur les jeunes artistes contemporains.
M. Taine ayant systématiquement et fort clairement exposé l'ensemble de la doctrine de la critique scientifique dans sa Philosophie de l'Art, c'est lui qu'il convient de discuter tout d'abord. Espérons que cette discussion convaincra le lecteur combien paradoxale est la thèse de M. Taine, combien vaine et même nuisible est sa méthode de critique, combien enfin elle est à côté de la tâche que doit se proposer la vraie critique.
La doctrine de M. Taine, on le sait, est basée sur cette idée qu'une œuvre d'art est un phénomène essentiellement relatif et contingent, qui n'existe pas en soi, et dont la seule valeur est d'être le témoignage de l'état psychologique d'un peuple à une époque donnée. Il nous explique bien quelque part certaines conditions esthétiques de l'œuvre d'art, mais ce sont plutôt les conditions par lesquelles une œuvre devient, par sa synthèse imitative, un bon document historique, que les conditions qui la rendraient belle en soi. La Kermesse de Rubens, selon lui, est un chef-d'œuvre parce qu'elle synthétise merveilleusement l'état psychologique et social des Flandres au temps de Rubens. Qu'on vienne un jour à découvrir (qu'on me pardonne cette hypothèse absurde) qu'elle n'est point de Rubens, qu'elle fut peinte ailleurs que dans les Flandres et à une époque qui n'était point le XVIIe siècle, comme M. Taine, dans son étude sur la Kermesse, ne nous a parlé que de tout cela, il est probable que pour lui elle n'aura plus aucune sorte de valeur.
Et, en effet, M. Taine, sans l'avouer explicitement, s'insoucie fort de la valeur esthétique absolue et inintrinsèque des œuvres. Celles-ci, ne l'intéressent que comme phénomènes de l'esprit humain ou comme documents historiques. Aussi, la critique qu'il préconise « a des sympathies pour toutes les formes de l'art et pour toutes les écoles, même pour celles qui semblent les plus opposées; elle les accepte comme autant de manifestations de l'esprit humain... » — Et il ajoute plus loin, un peu naïvement, « elle fait comme la botanique, qui étudie avec un intérêt égal tantôt l'oranger et le laurier, tantôt le sapin et le bouleau; elle est, elle-même, une sorte de botanique appliquée non aux plantes, mais aux œuvres humaines ». Evidemment, le devoir du botaniste est d'étudier avec le même zèle le cèdre et la moisissure, mais est-ce bien ce qu'on est en droit d'attendre d'un critique?
Quoi qu'il en soit, ceci une fois posé, la méthode qu'en déduit M. Taine est logique. Il ne perdra point son temps, comme ces critiques dogmatiques d'autrefois, a vous expliquer pourquoi une œuvre d'art est belle, il ne vous parlera même que fort peu de cette œuvre. Il se bornera, à propos de l'œuvre en question, a des considérations logiques de psychologie, de sociologie et d'histoire, convaincu qu'il a fait ainsi de la critique d'art.
Le point de départ de cette critique n'est point, comme il semblerait naturel, d'analyser les éléments de l'œuvre qui donnent la sensation de beauté. « Le point de départ de cette méthode, dit M. Taine lui-même, consiste à reconnaître qu'une œuvre d'art n'est pas isolée, par conséquent à chercher l'ensemble dont elle dépend et qui l'explique ». On le voit, la direction de la méthode est clairement indiquée. L'ancienne critique consistait à pénétrer autant que possible dans l'œuvre même, la nouvelle consiste a s'en éloigner méthodiquement autant que possible. Suivant cette direction, on constatera donc avant tout que l'œuvre en question « appartient d'abord à l'œuvre totale de l'artiste qui en est l'auteur », que cette œuvre totale, elle aussi, fait partie d'un ensemble « qui est l'école ou la famille d artistes du même pays et du même temps a laquelle il appartient ». Cela est vrai, mais déjà il y a peut-être lieu à quelque objection. On nous cite, pour corroborer cette assertion, Rubens : « Rubens semble un personnage unique, sans précurseurs et sans successeurs. Mais il suffit d'aller en Belgique... pour apercevoir tout un groupe de peintres dont le talent est semblable au sien : Crayer, d'abord, qui fut considéré de son temps comme son rival, Adam Van Noort, Gérard Zéghers, Rombouts, ete.; aujourd'hui, leur grand contemporain semble les effacer sous sa gloire, mais il n'en est pas moins vrai que, pour le comprendre, il faut rassembler autour de lui cette gerbe de talents dont il n'est que la plus haute tige, et cette famille d'artistes dont il est le plus illustre représentant. » Je ne veux point dire évidemment que cette étude comparative doive être négligée du critique, mais a-t-elle l'importance que M. Taine lui attribue?
Je ne crois point, pour ma part, qu'il soit impossible d'admirer et de comprendre Rubens à qui ignore Crayer et Rombouts. Et puis, il est à remarquer que ces ressemblances qu'on nous signale proviennent bien souvent d'une éducation commune, sous un maître commun, dont le succès et le génie servilement copiés ont supprimé toute l'originalité des artistes en question — qui, dès lors, doivent être jugés par rapport a leur modèle, et non leur modèle par rapport à eux-mêmes. Et puis, aussi, les artistes plus isolés que Rubens, complètement à part de leurs contemporains, ne sont point rares dans l'histoire de l'art.
Callot, etc. (3) En sont-ils pour cela moins intéressants?
Mais voici qu'on nous indique la troisième étape à franchir pour l'intelligence d'une œuvre d'art, — la troisième étape en lui tournant le dos : « Cette famille d'artistes elle-même est comprise dans un ensemble plus vaste qui est le monde qui l'entoure et dont le goût est conforme au sien. Car l'état des mœurs et de l'esprit est le même pour le public et pour les artistes, ils ne sont pas des hommes isolés. »
Certes non, les artistes ne sont pas des hommes isolés, et malheureusement! Malheureusement, oui, ils subissent l'influence des milieux, plus ou moins, malgré leur désir, qui est un devoir, de s'en éloigner et de s'en abstraire. Ils sont en quelque sorte des cygnes qui, par hasard tombés dans un bourbier, tâchent de se renvoler vers le ciel, mais dont les ailes ont été souillées par la boue du marécage. La critique scientifique a-t-elle donc raison de ne vouloir se préoccuper exclusivement que de ces taches de boue sur les ailes blanches? Prenez garde, M. Taine, le désir d étudier ces taches à la loupe conduit à prendre le cygne par le cou et à l'étrangler — comme Tribulat Bonhomet.
Et êtes-vous bien sûr que tous les artistes soient à ce point éclaboussés par la fange de vos fameux milieux ? Ne croyez-vous point qu'il en est sur les ailes de qui la boue ne saurait adhérer ou qui, en tous les cas, ne tardent guère à s'en débarrasser, dès leur premier vol, en se baignant en plein ciel ? Et ne pensez-vous pas, comme moi, que ce sont là les artistes supérieurs, je dirais presque les seuls' vrais artistes? Pensez-vous que l'Angelico ait beaucoup subi l'influence de l'Italie dissolue et sensuelle du XVe siècle; que, de nos jours, Puvis de Chavannes, cette âme de mystique païen, ou Gustave Moreau, ce rêveur de chimères triomphales et somptueuses, aient beaucoup à démêler avec leur siècle de myope analyse, hideusement industrialiste et utilitariste?
Mais, je le répète, lors même que cette influence existerait (et elle existe certainement et peut-être en raison inverse de la valeur des artistes), elle ne doit nous préoccuper que pour nous affliger, et il est absurde de penser que cette constatation soit le dernier mot de la compréhension d'une œuvre d'art, comme
le déclare M. Taine, qui, sans hésiter, arrive à « poser cette règle que, pour comprendre une œuvre d'art, un artiste, un groupe d'artistes, il faut se représenter avec exactitude l'état général de l'esprit et des mœurs des temps auxquels ils appartenaient. Là se trouve l'explication dernière, la réside la cause primitive qui détermine le reste. »
Et il ajoute:
« Supposez que par l'effet de ces découvertes on parvienne à définir la nature et marquer les conditions d'existence de chaque art, nous aurions alors une explication complète des beaux-arts et de l'art en général, c'est-a-dire une philosophie des beaux-arts; c'est là ce qu'on appelle une esthétique. Nous aspirons à celle-là et non pas à une autre. La nôtre est moderne et diffère de l'ancienne en ce qu'elle est historique, c'est-à-dire qu'elle n'impose pas de préceptes, mais qu'elle constate des lois. »
Est-il besoin de répéter que cette prétendue esthétique, d'abord, ne constate point des lois, mais des coïncidences, d'ailleurs rares et difficilement vérifiables; qu'il serait aisé de trouver un plus grand nombre de faits l'infirmant que la confirmant; et enfin qu'elle n'est nullement une esthétique, puisque sa préoccupation première n'est point l'art, mais les entours de l'art, point la toile mais le cadre ? M. Taine, en croyant faire de l'esthétique, fait de l'histoire, de la biographie, de la psychologie, de la sociologie, tout ce qu'on voudra excepté de l'esthétique. Hennequin, qui partageait son erreur, le comprit vaguement, puisqu'il proposa de rejeter ce mot et de le remplacer par celui d'esthopsychologie. Mais le nom ne fait rien à l'affaire; la méthode de M. Taine donnera et elle à donné des œuvres curieuses, intéressantes, mais elle n'arrivera jamais à la rigueur scientifique qu'elle ambitionne, parce que, comme je crois l'avoir montré, elle repose sur une pétition de principe, à savoir que l'intérêt d'art est proportionnel à la somme des influences de milieux subies par l'artiste, alors que la vérite se trouve évidemment dans cette proposition renversée. M. Taine m'apparaît comme un naïf observateur qui estimerait que c'est la forme, la dimension et la couleur du cadre qui a déterminé la forme, la dimension et la coloration de la toile.
Mais déjà, arrivé à ce point de sa doctrine, M. Taine s'aperçoit de l'impossibilité pratique de sa méthode.
II se rend vaguement compte que si le critique scientifique ne s'aide pas de quelques principes dogmatiques la critique lui deviendra purement et simplement impossible, puiqu'il sera obligé pour être logique d'accepter comme œuvres d'art, indistinctement, toutes les productions cérébro-manuelles de l'humanité.
Déjà, dans les pages qui précèdent, nous avons pu être surpris de le voir prendre comme thèmes d'expérimentation les œuvres de Rubens et de Michel-Ange. Pourquoi celles-là plutôt que telles ou telles croûtes, évidemment aussi intéressantes pour lui, s'il veut être logique avec sa déclaration antécédente : qu'il a « des sympathies » pour toutes « les manifestations de l'esprit humain »?
Serait-ce parce que ces œuvres sont consacrées, universellement admirées? Certes non, M. Taine est un esprit trop indépendant pour suivre ainsi sans raison personnelle l'opinion générale.
Serait-ce parce qu'elles l'ont surtout et d'abord ému par certaines qualités spéciales en elles immanentes?
Sans aucun doute. Mais alors n'aurait-il pas été logique de commencer par nous parler de cette émotion spéciale du sujet et de ces qualités spéciales de l'objet ? N'aurait-il pas été plus logique de nous parler d'abord de cette mystérieuse sensation de beauté qu'il avoue implicitement avoir éprouvée, de ce mystérieux don de beauté qu'il avoue implicitement avoir constaté? En un mot, ne fallait-il, pas poser le problème du beau et de la sensation esthétique avant celui des contingences conditionnelles de l'œuvre d'art?
Sans doute, cela aurait davantage ressemblé aux traités d'esthétique dogmatique, mais aussi M. Taine ne se serait point trouvé empêché d'avancer dès le deuxième pas de sa doctrine, et obligé d'avouer qu'il a exagéré en affirmant que toute manifestation de l'esprit humain, représentant fatalement les conditions de milieu où elle a été produite, était digne des sympathies du critique.
M. Taine, d'ailleurs, se tire fort subtilement de ce mauvais pas. Il sent la nécessité d'en revenir aux procédés de la critique dogmatique et il le fait sans avoir l'air de rien, avec tant de clownerie qu'on le remarque à peine. D'abord, il évite de trop montrer le bout de l'oreille en posant simplement, comme il en
a besoin, le problème du beau ou même du sens esthétique. Il se contente de poser le problème de l'art, chose plus concrète et conséquemment moins suspecte de métaphysicisme, et il dit négligemment, sans avoir l'air d'y toucher : « Je voudrais appliquer tout de suite cette méthode à la principale question par laquelle s'ouvre un cours d'esthétique et qui est la définition de l'art ». Et tout aussitôt il nous promet de ne point nous imposer une formule comme ces galeux de la critique dogmatique et « de nous faire toucher les faits »; et tout aussitôt, avant que nous ayons eu le temps de nous apercevoir combien peu scientifique et déductif était ce procédé de nous servir au début une définition qui ne devrait logiquement être qu'une conclusion, on nous présente cette formule, manifestement étroite et insuffisante, et qui n'a même pas l'avantage d'être beaucoup plus précise que les définitions métaphysiques dont il aime à se gausser:
« L'œuvre d'art a pour but de manifester quelque caractère essentiel ou saillant, partant quelque idée importante, plus clairement, plus complètement que ne le font les objets réels. Elle y arrive en employant un ensemble de parties liées, dont elle modifie systématiquement les rapports. Dans les trois arts d'imitation, sculpture, peinture et poésie, ces ensembles correspondent à des objets réels. »
Cette définition, quelque pauvre qu'elle soit, permettra à M. Taine de joindre à sa méthode d'investigation historique et psychologique une méthode de sélection sans laquelle rien n'eût été plus impraticable. Mais on observera dès maintenant combien cette définition, qui sert d'instrument de sélection, est étrange, puisqu'elle ne trouve dans l'art que des éléments intellectuels et aucun élément émotif ni même sensationnel.
Cette absurdité provient de ce qu'il eût fallu d'abord poser le problème de la sensation esthétique, et peut-être aussi celui du beau, avant de résoudre le problème de l'art. Mais cela, c'eût été introduire dans la fameuse méthode scientifique, au lieu d'une seule formule de la critique, dogmatique, deux et même trois de ces formules. Et M. Taine ne l'a pas voulu, préférant être incomplet et au besoin absurde que d'être accusé de dogmatisme.
Hennequin, en ce point moins excessif et plus logique que son maître, ne tombe pas dans cette
faiblesse. S'il n'analyse point l'œuvre d'art dans son essence, il l'analyse du moins dans son action, et il pose franchement le problème de la sensation du beau, qu'il analyse un peu superficiellement mais avec beaucoup de finesse et de subtilité. L'œuvre d'art, dit-il, a pour but « de produire une sorte spéciale d'émotion, l'émotion esthétique, qui a ceci de particulier qu'elle est fin en soi ». Et plus loin il ajoute : « Tous les systèmes de classification des émotions mettent à part les émotions esthétiques et en forment une division spéciale séparée des émotions ordinaires. Or nous avons vu que l'émotion esthétique est une forme inactive de l'émotion ordinaire et que chacune de ces dernières peut tour à tour devenir esthétique... » L'émotion esthétique, en effet, selon Hennequin, manque du caractère distinctif des émotions ordinaires: le plaisir et la peine ; — car il faut distinguer dans toute émotion ordinaire deux éléments : 1° l'excitation neutre, qui la constitue ; 2° le phénomène interne, cérébral, ajoutant des images douloureuses ou gaies. Or, ajoute Hennequin, « si on admet cette hypothèse, l'émotion esthétique d'un spectacle représenté se distinguera de l'émotion d'un spectacle réel perçu en ce que la première de ces émotions, tout en conservant intact l'élément excitation, laisse à son minimum d'intensité l'élément éveil des images de douleur ou de plaisir qui s'associent d'ordinaire à cette excitation, mais qui demeurent inertes parce qu'elles sont fictives, mensongères, innocentes. Au contraire, dans l'émotion réelle ces images ont toute l'intensité que leur donne la certitude de leur réalité... Or, si l'on accepte la théorie de M. Spencer d'après laquelle les plaisirs sont des sentiments modérés et les douleurs des sentiments extrêmes, on apercevra aussitôt la raison pour laquelle les œuvres les plus émouvantes et les plus estimées expriment des spectacles ou des idées tristes. C'est que dans celles-ci l'émotion causée par des images fictives, douloureuses, sera extrême; et, dans celles-ci également, l'émotion étant de l'ordre factice, fictif, esthétique, ne sera extrême que comme excitation et non comme douleur ». Et M. Hennequin conclut en se résumant : « Les mots sensation du beau sembleront donc désigner cette situation d'esprit: excitation intense d'un ou plusieurs sentiments ordinaires; absence des images positivement c'est-à-dire personnellement douloureuses qui accompagnent et
timbrent d'habitude cette excitation intense : en d'autres termes, le transport, le heurt de la douleur sans son amertume ou sa terreur ».
D'où cette définition un peu éloignée de celle de M. Taine : « L'art est la création en nos cœurs d'une puissante vie sans actes et sans douleurs ».
Je n'ai point à discuter ici cette analyse de la sensation du beau, évidemment superficielle et insuffisante. Je ne l'ai citée que pour démontrer que les partisans eux-mêmes de M. Taine avaient eu conscience de la lacune fondamentale de son système.
Quoi qu'il en soit, M. Taine, nous ayant, par sa définition de l'art, donné l'illusion d'une base solide de raisonnement (base dont il avait, je le répète, tout d'abord affirme pouvoir se passer), reprend l'exposé de son système de critique.
Sous prétexte d'étudier les lois de la production de l'œuvre d'art, il reprend sa théorie de l'influence des milieux, déjà formulée au début.
Deux formules, selon lui, suffisent à expliquer la création de cette chose sublime et complexe qui est une œuvre d'art.
La première formule est la suivante:
« L œuvre d'art est déterminée par un ensemble qui est l'état général de l'esprit et des mœurs environnantes. »
Et M. Taine invoque à l'appui de cette thèse deux preuves, l'une expérimentale, l'autre théorique.
La preuve expérimentale consiste à énumérer des cas nombreux où cette loi peut être constatée.
Nous avons déjà incidemment répondu à cette assertion, mais qu'il nous soit permis, puisqu'elle est fondamentale dans la doctrine, d'y insister de nouveau. Et d'abord, on peut observer combien, chez un critique persuadé a priori de cette vérité, l'expérimentation sera partiale, et, par conséquent,combien ledit critique sera tenté de collectionner les faits accidentels et de hasard qui semblent corroborer le principe en question pour les invoquer comme preuves absolues. Le fait que tel artiste ou tel groupe d'artistes violemment sensualistes ont vécu dans un milieu de sensualité n'implique pas fatalement que tout milieu sensualiste ne pourra déterminer que des artistes sensualistes. J'irai même plus loin, affirmant que, du fait qu'un artiste physiquement sensualiste a produit une œuvre sensualiste, il ne faut point inférer que tout artiste physiquement
sensualiste produira une œuvre sensualiste. Je crois, en effet, pour ce qui est de ce dernier cas, qu'il y a toujours lieu de distinguer en un artiste une double âme, son ame d'homme et son âme d'artiste. Les exemples à l'appui seraient nombreux. Voyez Corneille : son œuvre est éloquente, grandiloque, abondante; ce qui caractérise son âme d'artiste, c'est l'éloquence et la fierté; ce qui caractérise son âme d'homme, au dire de tous les biographes, c'est la timidité, le manque d'éloquence, la difficulté d'exprimer, le bégayement. Pérugin, dont l'œuvre est d'un croyant et d'un mystique, était, dit-on, dans sa vie d'homme, un athée et un matérialiste. Nous sommes donc forcé d'en conclure que si, dans l'artiste, il est une partie de l'âme qui subit l'influence des milieux, l'autre partie, la seule qui compte pour nous, peut s'isoler et ne rien subir de cette influence. Ecoutons, d'ailleurs, une phrase de M. Taine qui est un aveu de cela, et qui est aussi, de sa part, une comique et inattendue contradiction. Il parle de M. Ingres:
« Il a vécu, dit-il, à Paris, comme un plongeur sous sa cloche, fermant les fentes par où l'air du dehors eût pu entrer. Voyez son Plafond d'Homère, son Apothéose de Napoléon, sa Source. Sur d'autres terrains, il y a aussi beaucoup d'hommes qui, avec une persistance et une aptitude moindres, se sont construit leur cloche et y ont vécu. »
Eh oui, M. Taine ! Vous l'avez dit! Et cela eut lieu dans tous les temps, et cela fut, j'estime,à des degrés divers, le fait de tous les artistes; et cela, que vous le vouliez ou non, infirme votre doctrine.
La deuxième preuve invoquée à l'appui de l'assertion en question est, nous affirme-t-on, toute théorique. Elle consiste à proclamer l'insdispensabilité de l'action des milieux sur l'artiste et par conséquent sur l'œuvre d'art. On remarquera que je viens suffisamment de répondre à cela en discutant la preuve expérimentale. Que les milieux agissent sur l'artiste-homme, c'est possible et c'est probable; mais sur cette inviolable partie de son âme qui est son âme d'artiste, je le nie, et je crois qu'on peut, ainsi que je l'ai déjà indiqué, corroborer cette négation en poursuivant à travers toute l'histoire de l'art des preuves expérimentales analogues à celles que j'ai présentées. De plus, en restant à un point de vue purement théorique, je crois qu'on peut affirmer ceci : un artiste est, dans
une époque, et par définition, un être d'exception. Etre un être d'exception, c'est être en dehors de son époque. Un artiste est donc, également par définition, un être assez puissant pour réagir contre l'influence des milieux de cette époque, et l'on peut donc admettre que plus un artiste aura réagi contre ces influences, plus il aura cette faculté interne qui le constitue développée, et par conséquent plus il sera artiste. Ce qui signifie qu on peut arriver à cette formule : « L'oeuvre d'art est, en valeur, inversement proportionnelle à l'influence des milieux qu'elle a subie. »
Et cela, c'est, logiquement déduite, la réfutation suffisante de la deuxième preuve que M. Taine invoque à l'appui de sa thèse, la preuve théorique qui consiste a affirmer l'indispensabilité de l'influence des milieux sur l'artiste et par conséquent sur l'œuvre d'art. Avoir signalé le dédoublement de l'âme de l'artiste, constatable en fait et logiquement nécessaire, c'est avoir montré qu'alors même que l'artiste subirait comme homme l'influence des milieux, il peut fort bien et il doit ne pas la subir comme artiste, et que, par suite, ses œuvres peuvent et doivent ne conserver aucune trace de cette influence.
Pour établir la deuxième formule qui explique la création de l'œuvre d'art, M. Taine établit l'existence dans toute époque de ce qu'il nomme le personnage régnant. C'est un être synthétique résumant les sentiments, les aspirations, les aptitudes de l'époque. Chez les Grecs l'athlète, au moyen-Age le chevalier, au commencement du siècle Werther, sont des exemples de ce phénomène. Ce personnage régnant sert en quelque sorte de modèle à l'artiste, qui ou le reproduit sans trêve, ou tout au moins fait des œuvres s'adressant à lui, des œuvres capables de le satisfaire. « Une situation générale qui provoque des penchants et des facultés distinctes; un personnage régnant constitué par la prédominance de ces penchants et de ces facultés; des sons, formes, couleurs ou paroles qui rendent ce personnage sensible ou qui agréent aux penchants et aux facultés dont il est composé : tels sont les grands termes de la série. Le premier entraîne avec lui le second, qui entraîne... ete. Autant que j'en puis juger, cette formule ne laisse rien en dehors de ses prises...»
On observera ici, encore, que si cette formule contient quelque parole de vérité, elle est surtout vraie pour les artistes médiocres, pour les artistes qui
sont, à la vérité, le moins artistes — pour ceux-là même qui sont incapables de réagir contre l'influence des ambiances et qui, incapables de découvrir en eux un idéal, en sont réduits à en chercher un au dehors, et à exploiter, dans leur incapacité de création, l'idéal créé par d'autres. Un des exemples qu'on nous cite est mal choisi : Werther a été créé de toute pièce par Gœthe. Il étonna l'Allemagne par sa nouveauté et eut, indiscutablement, une action modificatrice sur l'esprit et les mœurs de l'Europe. Ce fut dans ce cas l'œuvre d'art qui eut une influence sur les milieux. Et si, postérieurement, ce type de Werther devint, pour la période romantique, le personnage régnant, c'est que les romantiques n'étaient pas vraiment des artistes. L'artiste véritable, c'était le créateur et non l'exploiteur, c'était Gœthe. Je crois d'ailleurs qu'il serait facile de trouver mille autres exemples aussi concluants, et qu'il n'est point absurde de soutenir que les poètes pindariques ont créé l'athlète idéal, qui domine la société grecque, bien plus qu'ils n'ont été déterminés par lui; et de même, que ce sont les poètes et les artistes du moyen-âge qui ont imposé à leur époque le type du chevalier, bien avant que la masse n'eût la compréhension de cet idéal.
En résumé, cette loi, presque vraie lorsqu'il s'agit des artistes médiocres, c'est-à-dire des artistes qui ne peuvent nous intéresser que comme manifestations historiques, devient absolument fausse dès qu'il s'agit des grands artistes vraiment originaux, qui seuls doivent compter. Ceux-là, en effet, nous les voyons tous ou créer spontanément, en le tirant d'eux-mêmes, un quelque chose qui peut, plus tard, mais seulement plus tard, devenir personnage régnant, ou créer des œuvres justement originales et immortelles parce qu'elles échappent à l'imitation de ce personnage régnant et à l'adaptation au goût de ce personnage régnant. Ainsi, bien que Pindare et les poètes pindariques vinssent de créer l'athlète comme personnage régnant, je ne discerne pas bien ce personnage régnant dans les sombres drames fatalistes d'Eschyle,et je ne vois guère que ces glorieux symboles aient été écrits pour l'exclusive joie des joueurs de' palestre ou de disque.
Une fois ces deux formules exposées, M. Taine, estimant qu'elles suffisent à expliquer la genèse d'une
oeuvre d'art, entreprend l'étude de l'œuvre d'art réalisée, c'est-à-dire de cette qualité spéciale qui fait que le réel n'est pas seulement le réel mais l'idéal. « Les choses, écrit-il, passent du réel à l'idéal, lorsque l'artiste les reproduit en les modifiant d'après son idée, et il les modifie d'après son idée, lorsque, concevant et dégageant en elles quelque caractère notable, il altère systématiquement les rapports naturels de leurs parties pour rendre ce caractère plus visible et plus dominateur. »
La première objection qui vient à l'esprit est celle-ci: sans doute, cette définition est acceptable bien qu'un peu étroite, mais elle a le tort de ne point différencier la valeur des diverses réalités logiquement altérées en vue de telles et telles diverses idées. Un imbécile, doué d'une bonne science acquise ou native, qui aura altéré les rapports de tels objets réels d'après une idée à lui, mais une idée stupide, aura idéalisé cette chose évidemment, mais quelle sera la valeur de cet idéal ? De plus, il est évident que la valeur de l'idéal ainsi entendu dépendra d'un autre élément, le degré de logique et de perfection des altérations et déformations systématiques dont on nous parle.
Cette double objection n'a point échappé à M. Taine. Le moyen le plus sûr d'en sortir était peut-être d'en revenir enfin à essayer de déterminer ce que c'est que le beau, et par conséquent ce que c'est qu'une belle idée, et par conséquent ce que c'est que l'idéal véritable, le seul qui compte en art. Mais cela, c'était faire de l'esthétique dogmatique, et l'on sait que M. Taine aime mieux être absurde que de dogmatiser. Il s'est d'ailleurs, cette fois, fort habilement tiré de ce mauvais pas en imaginant la théorie de la hiérarchie des idéaux, qui, au fond, je dois l'avouer, n'est pas complètement insoutenable.
A première vue, dit il, toutes les idées et partant toutes les idéalisations se valent. Mais il n'en n'est point ainsi si l'on approfondit. Le consentement universel, d'abord, l'analyse de la critique scientifique, ensuite, arrivent à nous convaincre que les idées ont des valeurs diverses et que tel idéal est supérieur à tel autre. Et l'on entreprend de nous démontrer que cette hiérarchie de l'idéal est subordonnée à trois facteurs : le degré d'importance du caractère dominateur, le degré de bienfaisance du caractère dominateur, le degré de convergence des effets.
Mais, tout aussitôt, dès cette énumération, nous nous apercevons qu'on nous a bernés en nous promettant une hiérarchie de l'idéal basée sur la différenciation des idées. Il n'est plus question, en effet, dans cette énumération, d'idée à proprement parler, c'est-à-dire des phénomènes subjectifs que l'artiste peut avoir à matérialiser à l'aide des réalités objectives (travail de tout l'art idéaliste). Au contraire, on n'entend plus par idée que les modes d'être ou de penser des réalités objectives. En un mot, on nous définit l'idéal de l'art qui a la prétention de se passer de l'idéal : du naturalisme. Courbet était plus franc, mais nous aurions dû nous y attendre.
En effet, lorsqu'on nous parle du degré d'importance du caractère, on n'a en vue que l'importance des divers modes d'existence de l'objet ou de l'être qui sert de modèle à l'artiste. On nous avertit que cette importance est déterminée par la loi physique dite : principe de subordination des caractères, et l'on nous apprend que les caractères les plus importants sont les moins variables. Cela peut être fort beau et fort juste, mais je ne vois pas qu'on nous parle beaucoup d'idées. Lorsque, aussi, l'on nous parle du degré de bienfaisance (4) du caractère et qu'on nous dit : «Toutes choses égales d'ailleurs, l'œuvre qui exprime un caractère bienfaisant est supérieure à l'œuvre qui exprime un caractère malfaisant », cette assertion me semble un peu enfantine. Voici deux tableaux de fleurs également
habiles : l'un représente des daturas, fleur vénéneuse par excellence,l'autre des mauves et autre fleurs médicinales; le degré d'idéalisation est plus élevé dans ce dernier que dans le premier. En effet « deux œuvres étant données, ajoute-t-on, si toutes deux mettent en scène, avec le même talent d'exécution, des forces naturelles de la même grandeur, celle qui représente un héros vaut mieux que celle qui nous représente un pleutre.»
Je ne vois pas bien, pour ma part, en supposant toutes choses égales d'ailleurs, en quoi don Rodrigue est, comme œuvre d'idéalisation, supérieur à Tartufe. On nous indique bien deux procédés infaillibles pour manier les caractères malfaisants. Les artistes qui désirent user de ces caractères « ou bien en font des accessoires et des repoussoirs qui servent à mettre en relief quelque figure principale... ou bien ils tournent nos sympathies contre le personnage; ils le font tomber de mésaventure en mésaventure, ils excitent contre lui le rire désapprobateur et vengeur, ils montrent avec intention les suites malencontreuses de son insuffisance, ils chassent et expulsent de la vie le défaut qui domine en lui ». Ce sont là, je le veux bien, de fort sages conseils, depuis longtemps suivis par les auteurs de toutes les bibliothèques Mame, où se prélassent, pour la plus grande joie de la jeunesse chrétienne, des scènes où le crime est puni et la vertu récompensée; mais je ne vois pas en quoi cette morale a affaire dans l'esthétique. Si Tartufe n'était point pris par les archers du roi, au Ve acte, la création de Molière en serait-elle donc plus mauvaise? J'opinerais presque pour le contraire. Mais cela, c'est pour le point de vue moral; pour le point de vue physique, on nous affirme que « toutes choses égales d'ailleurs, les œuvres seront plus ou moins belles, selon qu'elles exprimeront plus ou moins complètement les caractères dont la présence est un bienfait pour le corps ». D'où il résulte qu'un personnage académiquement bien musclé de Guido Reni est d'une idéalisation plus haute qu'une pauvre lymphatique et presque diaphane madone de l'Angelico ! Quoi qu'il en soit, dans cette question de l'examen des degrés de bienfaisance du caractère, il ne s'agit encore que des modes d'existence des objets objectivement considérés, et nullement d idées, ainsi qu'on avait semblé nous le promettre.
Enfin, lorsqu'on nous cite comme dernier criterium de la valeur d'un idéal la mesure du degré de convergence des effets, et qu'on nous dit : « Non seulement il faut que les caractères aient en eux-mêmes la plus grande valeur possible, mais encore il faut que, dans l'œuvre d'art, ils deviennent aussi dominateurs qu'il se pourra. C'est ainsi qu'ils recevront tout leur éclat et tout leur relief, de cette façon seulement ils seront plus visibles que dans la nature » ; lorsqu'on nous dit cela, on avoue implicitement peu se soucier d'un art où les idées subjectives de l'artiste auraient quelque place; on avoue ne désirer qu'un art réaliste, ultra-réaliste même, puisque son but sera non seulement de représenter l'objectivité, mais encore de la représenter exagérée et plus visible. Ces caractères de l'objet, ajoute-t-on, pour les rendre prédominants, c'est-à-dire, selon la théorie, « idéaux », « il faut évidemment que toutes les parties de l'œuvre contribuent à les manifester. Aucun élément ne doit rester inactif ou tirer l'attention d'un autre côté, ce serait une force employée à contre sens. En d'autres termes, dans un tableau, une statue, un poème, un édifice, une symphonie, tous les effets doivent être convergents. Le degré de cette convergence marque la place de l'œuvre....» «Toutes choses égales d'ailleurs, les œuvres seront plus ou moins belles selon que la convergence des effets sera chez elles plus ou moins complète. »
Et maintenant, M. Taine peut conclure:
« Les œuvres d'art sont d autant plus belles que le caractère s'imprime et s'exprime en elles avec un ascendant plus universellement dominateur. Le chefd'œuvre est celui dans lequel la plus grande puissance reçoit le plus grand développement. En langage de peintre, l'œuvre supérieure est celle où le caractère, qui dans la nature a la plus grande valeur possible, reçoit de l'art tout le surcroît possible de valeur. »
M. Taine peut conclure cela, il ne nous empêchera point de penser qu'il nous a trompés en nous déclarant d'abord que l'idéal était déterminé par la modification des choses réelles en vue de l'idée de l'artiste, que la hiérarchie de l'idéal était déterminée par la hiérarchie des idées, et en oubliant justement dans sa démonstration de nous parler des idées, de leur hiérarchie, des modifications possibles du réel en vue des idées. Il ne nous a parlé, au lieu des idées, que des modes
d'existence des choses objectives, et pour lui l'idéalisation n'est que la façon de rendre plus évidentes les modalités essentielles de ces choses. Conception qui revient à nier l'art idéaliste au profit de l'art réaliste. M.Taine, d'ailleurs, cite quelque par sans protester ce mot de Cellini. « Le point important de l'art du dessin c'est de bien faire un homme et une femme nus (132).» (5)
Et pourtant, il est évident que ces observations sur les importances diverses des divers caractères des choses ne sont point vaines absolument dans l'étude de la genèse de l'idéal. Si l'idéal consiste d'abord et avant tout dans les déformations que subissent les objets réels sous l'action des idées de l'artiste, et non point de toutes ses idées, mais de ses idées belles (chose que n'a pu établir M. Taine, je le répète, faute de croire à la possibilité d'une définition du beau), il n'en est pas moins vrai que les choses ont en elles des caractères qui sont en réalité les modalités des idées incluses en elles-mêmes, et que ces idées objectives rétroagissent de façons diverses sur les idées subjectives, et que dans la genèse de l'idéal collaborent deux travaux déformateurs du réel simultanément effectués par deux sortes d'idées et pour la définitive expression de ces deux sortes d'idées définitivement synthétisées dans l'œuvre d'art.
Mais, pour voir cela, il fallait avoir du monde une conception moins matérialiste et ne point préférer Aug. Comte et Condillac à Plotin ou à Platon.
Telle est, à peu près, exposée aussi brièvement que possible, avec les objections sommaires qui s'imposent à première lecture, la critique et l'esthétique de M. Taine. Cette doctrine eut, on le sait, un succès considérable. Les critiques de ce siècle, qui ont pour la plupart manqué d'esprit philosophique et d'idées générales, l'ont accueillie avec bonheur, par paresse de la discuter et par joie d'avoir une doctrine toute faite. Elle était d'ailleurs merveilleusement appropriée à l'esprit d'une époque sceptique et matérialiste qui n'est plus capable
de croire à aucun absolu et qui fait profession de bafouer les preuves rationnelles et de ne plus admettre que les preuves expérimentales, à une époque qui; ne pouvant pas plus aimer l'art que croire à une religion, se console, par coquetterie, en aimant l'histoire des religions et l'histoire de l'art.
Sainte-Beuve, comme je l'ai déjà dit, fut le grand metteur en œuvre de la doctrine. Son succès fut énorme. Il s'adressait a un public incapable d'aimer ou de comprendre une œuvre d'art, et qui pourtant ne voulait consentir a avouer cette impuissance. Il fut assez adroit pour lui faire croire qu'il lui parlait d'œuvres d'art, qu'il l'intéressait à des œuvres d'art. Le public fut enchanté, et ne s'aperçut point qu'au lieu de lui parler d'œuvres d'art on lui parlait d'artistes, ce qui est bien différent, de leur vie intime, de leurs parents, de leurs amis, ce qui est encore plus différent. On crut lire des articles de critique: c'étaient des anecdotes biographiques, des considérations historiques, philosophiques, ethnographiques, psychologiques, morales, parfois intéressantes et spirituelles, mais n'ayant jamais rien de commun avec l'esthétique ou la critique d'art.
Voici, d'ailleurs, comment Sainte-Beuve indique sa méthode. On verra qu'elle est peu différente de celle de M. Taine.
« II est donc convenu que pour aujourd'hui on m'accorde d'entrer dans quelques détails touchant la marche et la méthode que j'ai crue la meilleure à suivre dans l'examen des livres et des talents. La littérature, la production littéraire n'est pas pour moi distincte ou du moins séparable du reste de l'homme et de l'organisation ; je puis goûter une œuvre, mais il m'est difficile de la juger indépendamment de la connaissance de l'homme même ; et je dirais volontiers: Tel arbre, tel fruit. L'étude littéraire me mène ainsi tout naturellement à l'étude morale... Il est très utile d'abord de commencer par le commencement et, quand on en a les moyens, de prendre l'écrivain supérieur ou distingué dans son pays natal, dans sa race. Si l'on connaissait bien la race physiologiquement, les ascendants et ancêtres, on aurait un grand jour sur la qualité secrète et essentielle des esprits; mais le plus souvent cette racine profonde reste obscure et se dérobe. Dans le cas où elle ne se dérobe pas tout entière, on gagne beaucoup à l'observer. On reconnaît,
on retrouve à coup sûr l'homme supérieur, au moins en partie, dans ses parents, dans sa mère surtout, cette parente la plus directe et la plus certaine, dans ses sœurs aussi, dans ses frères, dans ses enfants mêmes. Il s'y rencontre des linéaments essentiels qui sont souvent masqués pour être trop condensés ou trop joints ensemble dans le grand individu... »
On le voit, Sainte-Beuve, lui aussi, ne semble pas se douter une minute que son métier l'autoriserait à se préoccuper de l'œuvre. Il semble croire qu'il n'est là que pour nous parler de l'auteur, de son père, de sa mère, de ses sœurs, de son concierge.
Plus loin, il ajoute:
« Quand on s'est bien édifié, autant qu'on le peut, sur les origines, sur la parenté immédiate et prochaine d'un écrivain éminent, un point essentiel est à déterminer après le chapitre de ses études et de son éducation: c'est le premier milieu, le premier groupe d'amis et de contemporains dans lequel il s'est trouvé au moment où son talent a éclaté, a pris corps et est devenu adulte. Le talent, en effet, en demeure marqué, et, quoi qu'il fasse ensuite, il s'en ressent toujours... Chaque ouvrage d'un auteur examiné de la sorte, a son point, après qu'on l'a replacé dans son cadre et entouré de toutes les circonstances qui l'ont vu naître, acquiert tout son sens — son sens historique et son sens littéraire — reprend son degré juste d'originalité, de nouveauté ou d'imitation, et l'on ne court pas risque, en le jugeant, d'inventer des beautés à faux et d'admirer à côté, comme cela est inévitable quand on s'en tient à la pure rhétorique. »
Ici, nous voyons intervenir timidement un élément nouveau, à peu près absent de la méthode de M. Taine, un élément qui semble pourtant devoir être la base primordiale et nécessaire de toute critique: le jugement. Sainte-Beuve admet le droit de juger une œuvre. M. Taine n'admet que le droit de constater impartialement ses éléments constitutifs. M. Hennequin, d'ailleurs, blâme vertement cette prétention de Sainte-Beuve et déclare formellement que le critique n'a ni à juger ni à apprécier. Il cite avec admiration l'exemple de M. Taine, qui « renonce, tout d'abord, tacitement, mais en pratique, à blâmer ou à louer les œuvres et les écrivains dont il parle ».Le fait qu'il s'en occupe lui parait suffire à indiquer qu'il les regarde comme doués de mérite ou comme significatifs, et cette attitude
attentive ou admirative une fois prise, il s'attache à résoudre les deux problèmes qu'il envisage. Mais Sainte-Beuve, je le répète, n'est point si excessif et ne veut point enlever paradoxalement au critique le droit de critiquer ni d'admirer. Il va même jusqu'à tenter de timidement légitimer la rhétorique, l'abominable rhétorique : « Sous ce nom de rhétorique, écrit-il, qui n'implique pas dans ma pensée une défaveur absolue, je suis bien loin de blâmer, d'ailleurs, et d'exclure les jugements de goût, les impressions immédiates et vives; je ne renonce pas à Quintilien, je le circonscris. Etre en histoire et en critique un disciple de Bacon me paraît le besoin du temps et une excellente condition première pour juger et goûter ensuite avec plus de sûreté. »
Etre un disciple de Bacon, et même de saint Thomas, n'adorer que les matérialités, nier la religion de tous les absolus, c'est sans doute le besoin du temps, mais est-ce bien une excellente condition pour juger et goûter l'art ? J'en doute. Quoi qu'il en soit, on voit que la doctrine de Sainte-Beuve diffère peu de celle de M. Taine; elle est moins systématique et moins intransigeante, voilà tout. Elle ne force pas aussi complètement le critique à ne faire que de l'histoire, de la psychologie, de la sociologie, de l'ethnographie, tout ce qui n'est point l'art. Elle ne lui interdit point avec tant de rigueur d'aimer, de comprendre, de juger l'art. Elle lui tolère ces faiblesses. Il est juste d'ajouter que, dans la pratique, l'auteur des Lundis n'abusa point de cette tolérance.
Tous les autres critiques modernes ont d'ailleurs entendu la critique de cette façon. Ils ont perpétuellement oublié de parler de l'œuvre d'art et se sont contentés de parler de l'artiste. Théophile Sylvestre, qui avait pourtant du goût et de la science, puisqu'il sut discerner tous les grands peintres de valeur de son temps, réduisit la critique à une sorte de reportage et d'interview comparable à l'enquête littéraire que M. Jules Huret a réalisée récemment. Ces livres où les artistes sont appelés eux-mêmes à témoigner de leurs désirs, de leurs rêves, de leurs théories, de leurs habitudes de vie même, sont loin d'être complètement dénués d'intérêt; mais sont-ils bien, à proprement parler, des livres de critique? Je ne crois pas qu'on
puisse le soutenir si l'on réfléchit quelque peu. Ils sont intéressants comme des albums d'autographes et de photographies. Voilà tout. Il est vrai qu'on est allé jusqu'à affirmer qu'un album d'autographes et de photographies suffisait, et qu'un des fidèles de l'esthétique scientifique, M. Emile Deschanel, présentait au public son livre, La Physiologie des Artistes, comme n'étant que cela. « Imaginez, disait-il, que vous feuilletez, pour passer le temps, un album d'autographes ou de photographies: c'est à peu près cela que je vous présente. » La promesse était exacte, car la critique scientifique aboutit en général à cela, et cet aveu est d'autant plus probant que quelques lignes plus haut M. Deschanel nous promettait de nous faire voir dans une œuvre d'art toutes les belles choses dont M. Taine fait tant mystère. « Je me propose donc simplement, disait-il, de faire voir par un certain nombre d'exemples et de faits comment on peut et on doit reconnaître dans une œuvre de style et d'art, non seulement le siècle où elle a été produite, mais aussi le climat, le pays, la race à laquelle appartient l'auteur; puis l'auteur lui-même, et son sexe, et peut-être son âge, mais très certainement sa complexion, son tempérament, son humeur, et, qui sait ? sa santé bonne ou mauvaise, à plus forte raison son caractère, son éducation, ses habitudes, son état et sa profession. » Mais tout cela, c'est-à-dire toutes les belles promesses de la critique scientifique, M. Deschanel lui-même l'a ingénument avoué, tout cela aboutit à des albums d'autographes et de photographies comme ceux de Th. Sylvestre, à des cancanages biographiques comme ceux de Sainte-Beuve ou d'Edmond Schérer, à des épiloguements historiques ou sociologiques comme ceux de Taine, d'Hennequin, de Mézières ou de Deschanel. Dans le métier de critique d'art ainsi entendu, on fait de la critique de tout excepté de l'art.
Et pourtant, soit impuissance à se créer une théorie autre, soit paresse, soit satisfaction, tous les critiques modernes ont, tacitement ou affirmativement, accepté cette méthode. A peine peut-on faire une exception pour le dogmatique Saint-Victor, pour Théophile Gautier qui tenta, mais sans aucun sens critique, des transpositions d'œuvres picturales en œuvres littéraires, pour Charles Baudelaire, aussi originalement novateur en critique qu'en poésie, enfin pour quelques écrivains plus immédiatement contemporains:
J.-K. Huysmans. Octave Mirbeau, Jean Dolent, Roger Marx, Geoffroy, Charles Morice. Mais tous, excepté peut-être ce dernier, ont échappé à la théorie Tainienne plutôt par un instinctif amour de l'art, par une haine irraisonnée du matérialisme de la science, que par un esprit de réaction consciente, théorique, raisonnée ; et c'est pourquoi cette discussion et cet essai de réfutation de la néfaste méthode de critique expérimentale n'étaient peut-être point vains.
Quoi qu'il en soit, je veux, pour être complet, signaler une orientation nouvelle de la critique scientifique, qui est de date assez récente... (6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une œuvre d'art est un être nouveau qui non seulement a une âme, mais une âme double (Ame de l'artiste et âme de la nature, père et mère).
Le seul moyen de pénétrer une chose, c'est l'amour. Pour comprendre Dieu, il faut l'aimer; pour comprendre la femme, il faut l'aimer ; la compréhension est proportionnelle à l'amour.
Le seul moyen de comprendre une œuvre d'art, c'est donc d'en devenir l'amant. Cette chose est possible, puisque l'œuvre est un être ayant une âme et la manifestant par un langage qu'on peut apprendre.
Il est même plus facile d'avoir pour une œuvre d'art l'AMOUR véritable que pour une femme, puisque dans l'œuvre d'art la matière existe à peine et ne fera presque jamais dégénérer l'amour en sensualisme.
On traitera peut-être cette méthode de ridicule. Alors je ne répondrai rien.
On la traitera peut-être de mystique. Alors je dirai ceci. Oui, sans doute, c'est là du mysticisme, et c'est le mysticisme qu'il faut aujourd'hui, et c'est le mysticisme qui seul peut sauver notre société de l'abrutissement, du sensualisme et de l'utilitarisme. Les facultés les plus nobles de notre âme sont en train de
s'atrophier. Dans cent ans, nous serons des brutes dont le seul idéal sera le commode assouvissement des fonctions corporelles; nous serons revenus, par la science positive, à l'animalité pure et simple. Il faut réagir. Il faut recultiver en nous les qualités supérieures de l'âme. Il faut redevenir mystiques. Il faut rapprendre l'amour, source de toute compréhension.
Mais, hélas, il est trop tard pour reconquérir l'amour dans toute son intégralité primitive. Le sensualisme du siècle nous a désappris de voir en la femme autre chose qu'un bloc de chair propre à l'assouvissement de nos désirs matériels. L'amour de la femme ne nous est plus permis. Le scepticisme du siècle nous a désappris de voir en Dieu autre chose qu'une abstraction nominale peut-être inexistante. L'amour de Dieu ne nous est plus permis.
Un seul amour nous est encore loisible, celui des œuvres d'art. Jetons-nous donc sur cette ultime planche de salut. Devenons les mystiques de l'art.
Et si nous n'y réussissons, retournons tristement à nos auges en gémissant le définitif Finis Galliae.
G.-Albert Aurier.
(1) La présente étude devait être mise en préface à un livre de Critique d'Art qu'allait prochainement publier Albert Aurier, et qu'on trouvera tout entier dans le volume d’Œuvres Posthumes en préparation. Elle n'est pas achevée; le manuscrit qui nous sert est de premier jet — comme, du reste, à l'exception des manuscrits de quelques poésies, tous ceux que nous publions — et il est certain que la forme, sinon le fond, du texte définitif eût été modifiée. — A. V.
(2) Ces mots : « Schiller l'avait constaté », ont été ajoutés après coup; ils sont suivis d'un renvoi au crayon bleu reproduit sur l'une des nombreuses notes qu'avait prises Aurier en vue de son étude. Il est donc probable qu'il l'eût intercalée dans le texte en recopiant le manuscrit. Voici cette note:
« L'utile est la grande idole de l'époque, toutes les forces s'emploient à son service, tous les talents lui rendent hommage. Dans cette balance grossière, le mérite spirituel de l'art n'est d'aucun poids, et, privé de tout encouragement, il disparait du marché bruyant du siècle. Il n'est pas jusqu'à l'esprit d'investigation philosophique qui n'enlève à l'imagination une province après l'autre, et les bornes de l'art se rétrécissent à mesure que la science agrandit son domaine. — Schiller, Lettres sur l'Education esthétique, 8, 189. »
(3) L'auteur se proposait ici d'ajouter quelques noms.
(4) Parmi des notes éparses, nous trouvons ce passage de Schiller, au bas duquel Aurier à écrit : « A citer en note à propos du degré de bienfaisance de M. Taine »:
« Toutes les propriétés par lesquelles un objet peut devenir esthétique peuvent se ramener à quatre classes qui, aussi bien d'après leur différence objective que d'après leur différente relation avec le sujet, produisent sur nos facultés passives et actives des plaisirs inégaux, non pas seulement en intensité, mais aussi en valeur: 'classes qui sont aussi d'une utilité inégale pour le but des beaux-arts. Ce sont l’agréable, le bon, le sublime et le beau. De ces quatre catégories, le sublime et le beau seuls appartiennent proprement à l'art. L'agréable n'est pas digne de l'art et le bon n'en est au moins pas le but : car le but de l'art est de plaire, et le bon, que nous le considérions soit en théorie, soit en pratique, ne peut ni ne doit servir de moyen pour satisfaire aux besoins de la sensibilité... Un objet peut, par sa nature intime, révolter le sens moral, et néanmoins plaire à l'imagination qui le contemple, et néanmoins être beau. — Schiller. Réflexions détachêes sur diverses questions d'esthétique, 8. 151. »
(5) Cette dernière phrase a été intercalée dans le manuscrit postérieurement à sa rédaction. Le chiffre entre parenthèses dont elle est suivie, simple repère pour l'auteur, semble indiquer qu'il voulait relire la page où M. Taine cite Cellini, et peut-être disserter de l'aphorisme. — A. V.
(6) Le manuscrit s'arrête sur cette phrase, début d'un paragraphe qui, vraisemblablement, aurait été le dernier avant celui où l'auteur eût défini sa méthode personnelle de critique. Mais parmi l'amas des notes (nous publierons dans le volume d'Œuvres Posthumes, à titre de documents, celles de ces notes qui n'ont pas été utilisées par Albert Aurier dans la première partie de sa préface), nous avons découvert le fragment que nous insérons à la suite: il semble bien que ce soit la conclusion de l'étude, et, à ce titre, il est infiniment précieux. — A.V.
- Pour fuir les plombs fondus, les pals et les marteaux,
- Ceux qu'avaient épargnés les vieux rites brutaux
- Gagnèrent, en pleurant, l'asile des bateaux...
- Ils jetaient dans la mer leurs ailes surannées,
- Et la berceuse mer berça bien des années
- Les nefs où gémissaient ces âmes condamnées...
- Hermès! Flambeau des nuits! Guide-nous où tu veux!...
- Et, bien longtemps, le vent marin, raillant leurs vœux,
- De ses doigts persifleurs caressa leurs cheveux...
- Alors que la tempête ébranlait leurs mâtures,
- Leurs fois, parfois, volaient vers des architectures
- De rêve, au pays d'or des bonnes aventures !...
- Et, parfois, le front bas, geignant, courbant le dos,
- Ils semblaient écrasés d'invisibles fardeaux...
- — Hermès! Quand verrons-nous les bleus Eldorados?...
- Ils voguaient, emplissant l'air de leurs voix dolentes,
- Insultant de leurs poings les voilures trop lentes
- Et suppliant des bras les vagues nonchalantes...
- Mais, pitoyant enfin à tous ces maux subis,
- Hermès, dieu des métaux, des sphynx et des ibis,
- Fit surgir à leurs yeux des paradis subits...
- C'était une île aux sables d'or, une grande île
- Où s'épanouissaient, près des tours de la ville,
- Des palmiers de saphir sous un doux ciel d'idylle.
- L'île où, dans les tiédeurs d'un constant messidor,
- Se sont baisés jadis Angélique et Médor,
- Où la flore et le sol semblent de gemme et d'or...
- Les cheveux constellés de pierres inconnues,
- S'avançaient à pas lents des jeunes femmes nues,
- Offrant aux étrangers des dons de bienvenues...
- Ils bénissaient Hermès, protecteur des ibis,
- Et, sur le littoral tapissé de tabis,
- Ruisselaient diamants, turquoises et rubis...
- Elles allaient, semant des parfums de pervenches,
- Offrant aux arrivants des cuisses et des hanches,
- Doux lit, jonché de lys, où dormir des nuits blanches...
- — Puisque les prêtres vils, loin de leurs impurs mets,
- Jadis, vous ont chassés, vous vivrez, désormais,
- Dans ce candide Eden qu'ils ne sauront jamais!...
- Ils plaindront votre exil sur l'île solitaire...
- Ne pouvant aborder la terre du Mystère,
- Ils diront son sol dur et son air délétère...
- Mais vous, loin des autels de leurs sanglants Molochs,
- N'ayant plus souvenir des glaives ni des socs,
- Et vos pieds ignorant les ronces et les rocs,
- Vous bénirez le ciel indulgent qui vous choie,
- Et, dans ce doux jardin de l'immuable joie,
- A jamais, vous vivrez des jours d'or et de soie !...
- Ainsi parla le dieu des ténébreux savoirs,
- Qui dicte aux faiseurs d'or les occultes devoirs,
- Hermès, berger des sphynx dans les royaumes noirs.
- Alors, les exilés des méchantes patries,
- Comme un avril qui monte en des branches flétries,
- Sentirent du printemps dans leurs âmes fleuries...
- Dans les prés de sinople ils allèrent s'asseoir...
- Le ciel était d'opale... Il faisait presque soir...
- Leur cœur s'évaporait ainsi qu'un encensoir...
- Les flûtes des Sylvains chantaient des chansons douces,
- Des naïades dansaient des rondes sur les mousses
- Et des fleurs de pêchers poudraient leurs toisons rousses.
- Et les flots bleus ceinturaient l'île, ainsi qu'un Styx...
- Des torrents de saphir tombaient des monts d'onyx...
- L'air était plein d'un vol d'aigles et de phénix...
- Sur un roc de cristal pleurait le luth d'Orphée,
- Et Sappho, pour baigner d'avril son corps de fée,
- Entr'ouvrait au zéphyr sa robe dégrafée...
- Acis, près, oh ! tout près de Galatée assis,
- Implorait le signal des sévères sourcils,
- Et Virgile rêvait dans les yeux d'Alexis....
- Et la brise emportait l'âme claire des chantres,
- Et les tigres broutaient des rosés dans leurs antres,
- Et les nymphes avaient des fleurs jusques aux ventres.
- Paris, près d'Héléna, disait des mots tout bas...
- Vierge folle arrachée aux rondes des Sabbats,
- Madeleine glissait l'or du Christ dans son bas...
- Et Pindare chantait les poings lourds des athlètes...
- Théocrite et Nisa fleurissaient des houlettes
- De guirlandes fleurant l'ambre des cassolettes....
- Homère célébrait les guerres de jadis...
- Et les blonds exilés des rivages maudits
- Sentaient bien qu'ils buvaient un peu de paradis...
- Des souffles imprégnés d'odeurs délicieuses
- Baignaient les nudités de leurs chairs otieuses...
- Et le sol rutilait de pierres précieuses...
- Et, déjà consolés des martyres subis,
- Ils contemplaient tous les joyaux d'Hermanubis,
- Les palmiers de saphir aux grappes de rubis,
- Les ruisseaux de turquoise et les monts de topazes,
- Les améthystes, les diamants des Caucases,
- Constellant les parvis dallés de chrysoprases,
- Les jades, les onyx, les verres, les émaux,
- Les coryndons, les jais, tous les soleils gemmaux
- Fleurissant l'émeraude et l'azur des rameaux.
- Et les doux exilés des méchantes patries,
- Comme un avril qui monte en des branches flétries,
- Sentaient sourdre un printemps dans leurs âmes fleuries.
- Mais, tout à coup, évocatrice du passé,
- Surgit des tours, les bras levés, le cil froncé,
- La fille du Soleil et de Persa, Circé !...
- Elle avance, Circé, théa des Etruries,
- Elle avance en l'azur bienveillant des prairies,
- Et son corps dévêtu brille de pierreries.
- Elle a des colliers lourds de clairs chrysobérils,
- Un soleil de rubis étoile son nombril,
- Et sa bouche fleurit d'un éternel avril;
- Ses regards sont couleur de la feuille des saules,
- Des oiseaux somptueux chantent sur ses épaules,
- Et son ventre est plus blanc que la neige des pôles.
- Un essaim de gais papillons envolés (1)
- Fleurit d'alertes fleurs ses cheveux violets,
- Des serpents sont tordus aux fûts de ses mollets,
- Les roses de ses seins brûlent comme des flammes,
- Et son corps est verni avec des amalgames
- Parfumés et brillants de laque et de cinnames.
- Les diamants et l'or ruissellent sur son corps...
- Elle avance, tenant dans ses doigts gantés d'or
- L'éclatant cinnor d'or, le sonore cinnor...
- Elle avance, Circé, théa des Etruries,
- Elle avance, en l'azur bienveillant des prairies,
- Son beau corps dévêtu brillant de pierreries.
- Magicienne, évocatrice du passé,
- Elle avance, les bras levés, le cil froncé,
- La fille du Soleil et de Persa, Circé !....
- Elle s'arrête enfin près du grand sycomore,
- Et c'est l'essor de ses doigts d'or sur lacmandore
- Et le sonore essor d'un chant couleur d'aurore.
- Sa voix a des échos sacrés d'harmonium,
- Et sa lèvre en bouton, peinte de minium,
- S'épanouit ainsi qu'un beau géranium...
- Les oiseaux se sont tus, les serpents adoucis,.
- Des papillons se sont posés sur ses sourcils...
- Elle chante les mots magiques que voici:
- Hermès! Hermès ! Hermharpocrate!
- Dieu des luths, des sphynx, des ibis!
- Tauth ! Fils du Nil et de l'Euphrate!
- Hermapollôn! Hermanubis!
- Dieu des couleuvres bicéphales!
- Dieu des cabales triomphales!
- Dieu des pierres philosophales!
- Et des creusets pleins de rubis!
- Hermès ! Herméros! Herméracle!
- Gardien des trous noirs du trésor,
- Semant dans la nuit de l'oracle
- Le sourire des astres d'or!
- Hermès ! Protecteur charitable
- De qui le proscrit lamentable
- Attend le baume indubitable
- Et l'aile pour le bon essor!
- Hermès ! Mercure Trismégiste!
- Mercure! Dompteur des coursiers!
- Dieu qu'invoque le théurgiste,
- De nuit, loin des forums grossiers!
- Hermès ! Baume des cicatrices!
- Toi, dont les mains consolatrices
- Fleurissent lèvres et matrices!
- Dieu des savants et des sorciers!
- Divin Hermès qui fais éclore
- Le métal d'or dans les creusets!
- Dieu qui baignes d'aurore (sic)
- Les fronts anathématisés!
- Dieu qui semas nos deuils moroses
- De gemmes, d'astres et de roses
- Et qui comblas d'apothéoses
- Nos pauvres cœurs martyrisés!
- Hermès, riant et bénévole!
- Reçois nos vœux reconnaissants!
- Reçois l'âme de mes paroles!
- Reçois mes paroles d'encens!
- Métamorphose en nard, en myrrhe,
- En cinname de Cachemire,
- En ambre, en baume de Palmyre,
- Tous mes cantiques impuissants!
- Que mon cœur s'évapore comme
- Un religieux encensoir !...
- Et qu'il baigne de cinnamome
- Le trône où je t'ai vu t'asseoir!
- Ne rends pas mes louanges vaines!
- Fais couler du feu dans mes veines!
- Que mes chants te soient des verveines!
- Mes mots, les astres d'un beau soir!
- Dans les Mystères ineffables,
- Nous prélassons nos membres nus !...
- Nous vivons sous des ciels de fables
- Des baisers que nul n'a connus...
- Les Mages aux âmes flétries,
- Restés dans nos vieilles patries,
- Ignorant nos forêts fleuries,
- Raillent nos exils ingénus !...
- Nos brocarts leur semblent des loques !...
- Que nous importe leur mépris?
- Que nous importe qu'on se moque
- Des hymnes qu'on n'a point compris?
- Et que nous importe le nombre
- Des aveugles à l'âme sombre
- Dont l'œil séché prend pour de l'ombre
- Nos gais midis clairs et fleuris?
- Mes verbes dansent en délire,
- Captifs évadés des cachots !...
- Mon cœur frémit comme une lyre!
- Mon ventre est plein de parfums chauds!
- Mes mains ont des gestes de reines!
- Mon âme est pleine de Sirènes
- Chantant des Péans et des Thrênes
- Dans le nuage des réchauds!...
- Hermès! Mon corps roule parterre,
- Ivre de chansons et d'encens!...
- J'ai bu le vin noir du Mystère!
- J'ai bu des lions rugissants!
- Hermès ! La neige de mes hanches,
- Vole comme des plumes blanches
- Et mes yeux pleurent des pervenches
- Et des saphirs éblouissants !...
- Hermès! Hermès ! Hermharpocrate!
- Dieu des luths, des sphynx, des ibis!
- Tauth ! fils du Nil et de l'Euphrate!
- Hermapollôn! Hermanubis!
- Dieu des couleuvres bicéphales!
- Dieu des cabales triomphales!
- Dieu des pierres philosophales
- Et des creusets pleins de rubis !. . .
- Ainsi parla Circé, théa des Etruries,
- Dont le corps dévêtu brillait de pierreries,
- Au milieu de l'azur bienveillant des prairies !...
- Et, ses deux yeux pleins de saphirs éblouissants,
- Et son cœur défaillant de musique et d'encens,
- Et saoule d'avoir bu des lions rugissants,
- D'avoir bu, d'une gorge et d'une âme voraces,
- De l'azur, du soleil, du ciel et de l'espace,
- Et d'avoir contemplé le dieu Tauth face à face,
- Elle tordit son corps, reptile convulsé,
- Et, comme un beau serpent qu'un dard a traversé,
- Morte, elle s'écroula, l'ondoyante Circé.
- Les clairons d'or sonnaient sous les bleus sycomores,
- Et l'essaim voltigeant et blond des cystophores
- Lui présentait le talisman des mandragores,
- La fleur qui fait revivre et le saint bézoard...
- Soudain s'est rouverte la bouche!... Et l'œil hagard...
- Et le sang s'est remis à couler sous son fard !...
- Et les doux exilés des méchantes patries,
- Comme un avril qui monte en des branches flétries
- Sentant sourdre un printemps dans leurs tètes fleuries
- Comprirent qu'ils étaient : des Effluves d'encens,
- Des Ames, des Parfums, des Papillons, dansant
- Dans la Respiration de l'Etre Eblouissant !...
- Nos brocarts leur semblent des loques...
- Que nous importe leur mépris?
- Que nous importe qu'on se moque
- Des hymnes qu'on n'a point compris?
- Et que nous importe le nombre
- Des aveugles à l'âme sombre
- Dont l'œil séché prend pour de l'ombre
- Nos gais midis clairs et fleuris !...
Juin 1890.
G.-Albert Aurier
(1) Erreur de copie sans doute: nous n'avons pas retrouvé le premier manuscrit. — A. V.
Arlequin (seul). — Drôle d'idée, pourtant, de m'avoir donné rendez-vous dans un cimetière! Faut-il que ces femmes soient romantiques! Un duo d'amour parmi des tombes ! C'est d'un 1830! d'un rococo! d'un Shakespearien ! (Il se promène impatiemment en roulant une cigarette.)— Tiens! un crâne! Un crâne !... Faut-il que ce cimetière soit mal entretenu ! (Il le ramasse.) — Ah! non, c'est une boule à quilles !... Beau sujet de méditation pour un poète de la vieille école. (Il regarde le crâne en une pose d'Hamlet) Etre ou ne pas être, telle est la question ! Mourir, dormir !... Dormir, peut-être rêver !... Crâne ! Boule à quilles! Boule à quilles! Crâne !... Kif-kif! comme disent les Arabes !... Mais elle ne vient point. Tiens ! Des pas !... Qui diable peut se promener à pareille heure dans un pareil décor de mélodrame !... Ah ! un fossoyeur...
Arlequin. — Bonsoir, l'ami !...
Le Fossoyeur. — Bonsoir, seigneur Arlequin!
Arlequin (à part). — Donnons-lui le change sur le motif de ma présence ici.(Haut.) Tu vois, l'ami, j'étais venu dans ton cimetière faire des vers, et, ma foi, j'attendais... j'attendais l'inspiration...
Le Fossoyeur. — Eh bien, vous n'attendrez pas longtemps.... Elle vient... Dans cinq minutes
au plus, elle sera ici.... Je l'ai aperçue là-bas qui passait devant la croix du carrefour...
Arlequin. — Comment ? Qui ça? L'Inspiration?
Le Fossoyeur. — L'inspiration, Colombine, votre maîtresse, Madame Pierrot, comme vous voudrez, l'appeler... Je ne discute jamais sur les mots...
Arlequin. — Alors, vous savez?...
Le Fossoyeur. — Parbleu !... Je sais ce que tout le monde sait... C'est un bruit de ville...
Arlequin. — Oh ! Après tout! Peu m'importe. Comme je compte bien l'épouser dans peu...
Le Fossoyeur. — Comment, l'épouser? Eh bien, et Pierrot ?...
Arlequin. — Nous avons le divorce...
Le Fossoyeur. — Mais, Monsieur, vous l'aimez donc bien?
Arlequin.— Moi, oui, non, pas plus que cela... Enfin... je l'aime, comme on aime une bonne affaire bien avantageuse... bien lucrative...
Le Fossoyeur. — Mais,Monsieur, Colombine n'a pas le sou.... Elle crève de faim avec son fou de mari.... Hier encore,je l'ai vue porter son dernier matelas au Mont-de-Piété !...
Arlequin. — Mon ami, tu n'as aucune idée de la situation... Mais, au surplus, je peux bien t'instruire.... Tu as une tête de sage, et je te devine discret comme les tombes que tu creuses avec tant d'art... Donc, voici... Colombine, évidemment, n'a pas le sou.... Mais son père, Cassandre, est riche, colossalement riche. Il a fait une fortune immense, en sachant se faire concéder par les prévôts de la ville le monopole des vidanges. Il adore sa fille, et il était disposé à la doter convenablement. Je puis te dire le chiffre: cinq cent mille livres... Or, lorsque, il y a dix ans, il songea à la marier, deux prétendants se présentèrent; l'un, poète étique, rimailleur famélique de ballades à la Lune: c'était Pierrot; l'autre, poète aussi, mais poète intelligent, adroit, souple, travaillant moins pour les planètes que pour les riches et
puissantes dames, et dès lors, malgré sa jeunesse, visiblement prédestiné à la fortune, aux honneurs, à la gloire et à l'Académie : c'était moi... Je plus à Cassandre, mais Pierrot plut à Colombine, et lui plut tant que la petite bête se laissa enlever par lui. Cassandre, furieux, jura de déshériter sa fille, et, de fait, refusa de la doter. Les deux époux traînèrent une vie misérable, Pierrot toujours rimaillant les louanges de l'inattendrissable Phœbé, Colombine obligée, pour vivre, de donner en ville des leçons de piano à trente sous!.. Et pendant ce temps-là, ton serviteur, le seigneur Arlequin, avait fait tout doucement son chemin, poussé par les gens du monde pour lesquels seuls il travaillait. Il était devenu un auteur fameux que s'arrachaient les libraires. Il était millionnaire, décoré de tous les ordres et membre de l'Institut. Mais, pourtant, ce qui devait arriver arriva. Colombine avait vieilli, et, la trentaine gagnée, avait fini par s'apercevoir que sa vie avec un crève-de faim, éternel rumineur de songes creux, était tout bonnement insoutenable. Alors, elle se prit à resonger de moi, sachant bien quelles étaient ma position, ma fortune, ma célébrité, et n'ignorant pas que Cassandre lui baillerait les cinq cent mille livres de dot autrefois promises si elle trouvait moyen de lui donner un gendre tel que moi... Comprends-tu, l'ami?
Le Fossoyeur. — Parfaitement! seigneur Arlequin, parfaitement!... Mais Pierrot n'essaiera-t-il pas de vous disputer sa légitime épouse?
Arlequin. — Pierrot ?... Bah !... Il gémira !... Il pleurnichera!... Il chantera des élégies !... Car il adore Colombine !... Il l'adore comme la Lune, ce qui n'est pas peu dire !... Mais il ne trouvera rien de pratique à nous opposer... C'est un poète, rien qu'un poète, c'est-à-dire un imbécile.
Le Fossoyeur. — Comment? Un poète, c'est-à-dire un imbécile.... Mais, vous-même, ne m'avez vous point dit que vous étiez aussi un poète?
Arlequin. — Sans doute, l'ami, mais il y a poète et poète.
Le Fossoyeur. — Ah !...
Arlequin. — Des pas! C'est elle! C'est Colombine! Eh, l'ami, je te prie, laisse-nous seuls.
(Sort le Fossoyeur.)
Colombine. — Bonsoir, seigneur Arlequin... Je suis un peu en retard, excusez-moi...
Arlequin. — Lorsque l'aurore se décide à paraître, qui donc oserait...
Colombine. — Oh ! de grâce, mon ami, point de madrigaux !... Nous ne sommes point ici à un rendez-vous d'amour, mais à un rendez-vous d'affaires.
Arlequin. — C'est juste ! Mais, pourtant, il serait peut-être excessif d'écarter toute phrase d'amour de notre conversation... Car, enfin, je vous aime, moi... Et vous, Colombine, m'aimez-vous?
Colombine. — Mais, sans doute, mon petit Arlequin... Je vous aime, je vous aime bien... mais non plus comme j'aimais autrefois, en petite folle... Je vous aime en femme raisonnable, parce que j'ai conscience de vos mérites, parce que je sais que vous pouvez me rendre heureuse et que je puis vous rendre heureux...
Arlequin. — C'est sagement parler, en petite femme très moderne, pas romantique... Et ce langage m'enchante.... Ah! Colombine!... Lorsque j'aurai une petite femme comme toi... je ne connaîtrai plus d'obstacles... l'avenir m'appartiendra... nous appartiendra... et je veux faire de toi la femme la plus riche, la plus heureuse, la plus glorieuse... Mais, au moins, c'est bien sûr, tu n'aimes plus Pierrot ?...
Colombine. — Quelle question !... Je le hais !... Est-on folle, mon Dieu, quand on est gamine !... Dire que j'ai adoré ce pâle jocrisse, incapable de gagner cent sous dans une année !... Mais j'en ai assez de cette existence de misère!... et de donner des leçons de piano à trente sous !...
Arlequin. — Alors, embrasse-mol, ma petite Colombine.
Colombine. — Tiens, voilà. (Elle l'embrasse.)
Arlequin. — Maintenant, parlons sérieusement. Où en sont nos affaires?
Colombine. — J'ai vu papa. . . Il a toujours mêmes intentions. Si je divorce et si je t'épouse, il nous donne la dot convenue: cinq cent mille livres...
Arlequin. — Cinq cent mille livres, bien!
Colombine. — Oui : cent mille francs d'argent comptant, d'abord; deux fermes et une maison estimées deux cent cinquante mille livres; le reste en valeurs sûres, garanties par la Caisse du royaume et rapportant cinq pour cent... donc...
Arlequin. — Colombine, tu es une petite femme adorable...
Colombine. — Donc, nous aurons d'abord le revenu des deux cent cinquante mille francs de propriétés, montant, bon an mal an, à quatre mille cinq cents livres... Les cent mille livres d'argent comptant, nous les placerons dans une entreprise minière que papa m'a indiquée, avec garantie hypothécaire, très sûre, première hypothèque sur des immeubles d'une valeur quadruple, et nous prélèverons un intérêt de six pour cent ; total six mille livres!
Le Fossoyeur (caché derrière une tombe, monologuant). — Quel drôle de duo d'amour !... Voilà pourtant comme sont les amoureux de maintenant... Bah! Après tout, ils ont peut-être raison... Ce n'est pas l'amour qui fait le bonheur.
Colombine. — Plus les cent cinquante mille livres en obligations sur les Caisses du royaume, représentant, à cinq pour cent, un revenu net de sept mille cinq cents francs... Donc, en récapitulant, nous avons, d'une part, quatre mille cinq cents; d'autre part, six mille; d'autre part, sept mille cinq cents : total dix-huit mille livres... Avec dix-huit mille livres de revenu, on peut vivre.
Arlequin. — Mal!... Mais comme, de mon côté, j'apporterai dans la communauté un revenu à peu
près égal : d'une part, mes droits d'auteur, tant comme romancier que comme poète et dramaturge; d'autre part, mes jetons de présence à l'Académie ; d'autre part...
Le Fossoyeur (à part, toujours caché). — Autrefois, la jeunesse était moins sage, moins sage, vraiment.
Colombine. — Bref, mon petit Arlequin, nous aurons de quoi vivre à notre aise... Vois-tu, moi, j'estime maintenant que l'amour n'est possible qu'avec le confortable.
Arlequin. — Oui, oui, certes, nous aurons de quoi vivre à notre aise, et si Dieu nous donne des enfants, un fils par exemple...
Colombine. — Nous le mettrons à l'Ecole Polytechnique.
Arlequin. — Colombine, tu es un ange... Je t'adore... Tu devines toutes mes aspirations... Tu es digne d'être ma muse, la muse de la poésie moderne !... Permets que je t'embrasse.
Colombine. — Quant au régime matrimonial, papa désirait que nous adoptassions le dotal, mais je lui ai objecté qu'avec un homme aussi intelligent et aussi pratique que toi, ce régime était non seulement inutile, mais susceptible de nous nuire,... Il a compris, et si le régime de la communauté te plaît... Quant à mes paraphernaux...
Arlequin. — Oui, Colombine, mais as-tu songé au moyen d'obtenir le divorce?
Colombine. — Je ne suis pas très fixée... Il y a bien le flagrant délit d'adultère... Mais ça nuit, ensuite, pour les relations, et comme nous aurons besoin de relations...
Arlequin. — A moins que ce ne soit Pierrot qui donne en personne le coup de canif dans le contrat, et ce au domicile conjugal... Nous le surprenons... et....
Colombine. — Impossible, mon cher, ce niais de Pierrot n'a jamais eu au cœur qu'un seul vrai amour, celui de la Lune... Tu comprends qu'aucun commissaire ne consentira à constater un flagrant
délit d'adultère avec une personne aussi sidérale.
Arlequin. — Reste les coups, sévices et injures graves !... Ma petite Colombine, il faut te résoudre à te faire bâtonner.
Colombine. — Tu en parles à ton aise, toi...
Arlequin. — Oh ! je me tiendrai caché, prêt à te défendre et à constater...
Colombine. — Et puis, ça n'est pas facile !.. Pierrot n'est guère acariâtre.... Il est doux comme un mouton, indifférent plutôt...
Arlequin. — Diable !
Colombine. — Pourtant... pourtant... quelquefois, lorsqu'il a la cervelle turlupinée par quelque rime qui ne vient pas... et qu'on le dérange... il grinche.... Enfin j'essaierai....
Arlequin. — Oui, en choisissant adroitement le moment...
Colombine. — Et en étant incomparablement insupportable.
Arlequin. — Tiens! Tiens !... Quelle est cette forme blanche qui erre parmi les tombes, là-bas, dans le lointain.
Colombine. — Ah ! Mon Dieu! Un fantôme!... Sauvons-nous!
Arlequin. — Mais non ! Mais non ! Par ma batte, je ne me trompe pas, c'est ton mari, c'est Pierrot !... Que diable vient-il faire ici, dans ce cimetière, à cette heure?
Colombine. — C'est sa promenade favorite, la nuit... Il prétend que dans ce silence l'inspiration...
Arlequin. — Mais il est avec quelqu'un.
Colombine. — Eh ! oui, il parle avec quelqu'un.
Arlequin.— Mais... c'est Monsieur Barbin, le libraire...
Colombine. — Cachons-nous, les voici... Aussitôt que son libraire se sera retiré, je me montrerai... Je lui ferai une scène de harpie, et s'il porte la main sur moi...
Arlequin. — Cachons-nous derrière ces tombes... Les voici.
M. Barbin. — Evidemment!...Je ne dis pas non !... C'est charmant, votre petit recueil! C'est charmant ! Monsieur Pierrot ! Mais, que voulez-vous que je vous dise? Le public n'aime pas cela! C'est trop élevé... Et puis, vous êtes obscur, Monsieur Pierrot, vous êtes obscur! Pourquoi ne faites-vous pas comme Arlequin, le jeune et sympathique académicien, le poète à la mode, des petits contes en vers, parfumés à la vanille, à l'usage des salons du grand monde, ou bien encore des faits-divers émouvants racontés en alexandrins... Ça passionne le public, ça... Le fait-divers, voyez-vous, voilà l'avenir de la poésie... Ah ! je sais bien,vous allez me dire que ça n'est pas dans vos cordes... Alors, écrivez des romans...Ça se vend encore mieux...
Pierrot. — Mais je ne suis pas romancier, Monsieur Barbin.
M. Barbin. — Tant pis ! Monsieur Pierrot, tant pis !... J'ai bien l'honneur de vous saluer.
Pierrot. —C'est Colombine qui ne sera pas contente... Pauvre petite Colombine !... Tiens, la lune!... (2) Dis-moi, Lune, es-tu le soupirail de la
cave obscure où nous nous débattons ? Es-tu le soupirail ouvrant sur les radiances de l'infini, sur l'éblouissant Paradis? O brillant soupirail, ô lucarne ouvrant sur l'espérance, que j'aimerais, donnant, comme un bon nageur, un coup de talon au fond de ce marécage, monter et traverser ton orbe éblouissant! Que j'aimerais crever ton disque de lumière, ainsi qu'un clown de cirque crève son cerceau de papier doré ! Hélas !... sur cette terre maudite, faire un trou dans la lune n'est guère honorable, pas plus pour un poète que pour un banquier... Pour être considéré, il faut faire son trou comme le stercophore...
Ce libraire me semble un homme fort sensé, comme qui dirait un grave et sage proxénète. Au fond, il me conseillait d'entrer en son honorable boutique pour y faire le métier de courtisane. Etre poète de la manière qu'il disait, c'est, si je
ne m'abuse, faire la courtisane, c'est décocher des sourires et montrer ses mollets sur la place publique pour raccrocher les passants, c'est brocanter la chair de son rêve, c'est se vendre... J'aimerais mieux me pendre... Me pendre !... Peut-être y serai-je bientôt forcé! Que fais-je sur cette terre, en somme? C'est par distraction, sans doute, que la destinée m'a laissé tomber sur cette planète, où je n'ai que faire, parmi ces gens dont je ne puis comprendre ni le langage, ni les gestes, et qui me comprennent encore moins... Hélas! il y a quelques quarante ans que je traîne la plus vaine et la plus pitoyable des existences, crevant de faim et pourchassé par les huissiers ! Mes cheveux ont blanchi, je suis devenu étique comme un squelette, et ce candide costume tissé de blancheurs qui faisait jadis mon orgueil n'est plus qu'une lamentable loque sur ma maigre échine...
J'avais cru trouver un être qui me comprenait et qui m'aimait... une femme si rose, si blonde et si douce qu'elle semblait la petite sœur de mon éternelle amante, la Lune... Je l'enlevai, j'en fis ma femme... Hélas! Je ne tardai point à m'apercevoir que Colombine n'était rien moins que ce que j'avais rêvé .. Je me grisais de chansons et d'airs de guitare, elle pleurnichait sur notre huche vide ! Au fond, peut-être avait-elle raison ? Peut-être le libraire, peut-être Arlequin, peut-être tout le monde ici-bas a-t-il raison? Et peut-être ne suis-je, moi, qu'un sot et un fou ?... Alors, à quoi bon vivre?... J'ai commencé,petit Pierrot joyeux, par croire à tout, par aimer tout... Puis, quand j'ai compris ou cru comprendre, je me suis convaincu qu'il n'y avait encore de bon et de vrai que cet illusoire que nous faisons jaillir de notre cervelle, vêtu du somptueux costume des rimes et des rhythmes, que ce cher illusoire qui nous charme une minute, qui une minute nous fait crever d'orgueil et nous paraît créé pour l'immortalité, mais qui, hélas, ne tarde guère à s'évanouir comme des bulles de savon !... Et maintenant, je le sens, je suis prêt à perdre cette croyance à ces riens délicieux... Alors, pourquoi vivre, à quoi bon vivre?... J'ai envie de me pendre...
Arlequin. — S'il pouvait le faire comme il le dit !... Ça simplifierait notre combinaison.
Colombine. — Tais-toi, Arlequin, c'est mal ce que tu dis!
Arlequin. — Bah!.. Avoue, Colombine, que tu penses tout bas ce que je dis tout haut.
Colombine. — Tais-toi, Arlequin, tu m'ennuies...
Pierrot (seul). — Me pendre, oui !... Peut-être est-ce là le moyen, la solution, l'issue... Oh! Voici la lune qui brille !... Oh! oui, j'en suis sur ce soir, c'est bien la lucarne ouvrant sur le
Paradis... J'en suis sûr... J'aperçois par cet éblouissant soupirail un coin du ciel... Je vois... Il y a des anges... qui chantent... qui chantent... qui chantent... Ah ! il est donc permis de chanter dans le ciel... Oh ! me pendre ! Mon âme déploierait enfin ses belles grandes ailes, elle monterait, elle monterait, heureuse et grave, à travers l'éther, délivrée, elle plongerait comme en un puits de lumière dans cette tentatrice lucarne, elle irait vivre enfin dans ce bleu et radieux pays où l'on a le droit de chanter !...
Arlequin. — Il a l'air de se décider .. Cela simplifierait les choses... Les procédures du divorce sont longues et onéreuses... Tandis qu'un bon petit enterrement...
Colombine. — Reviendrait à peu près aussi cher, si nous voulons faire les choses convenablement.
Arlequin. — Tu plaisantes.
Colombine. — Comment, je plaisante? Un convoi de deuxième classe au moins, le clergé, le marbrier, les toilettes de deuil...
Arlequin. — C'est égal! Pour mille raisons, j'aimerais mieux ça!
Pierrot.— Oh! avoir enfin le droit de chanter!... O Lune !... O soupirail tentateur du Paradis !... O puits insondable de lumière ! Tu m'attires, tu m'attires... Quand je te regarde, ma tête tourne, j'ai le vertige... Oh ! j'ai le vertige comme si je me penchais sur le bord d'un gouffre effroyable et charmant... Tu m'attires, oui, tu m'appelles, ô Lune bienveillante, ô consolatrice, tu m'appelles de tes blonds sourires, tu m'appelles... Pourquoi te résisterais-je? Pourquoi ? Ah! si j'avais une corde!... rien qu'une corde!...
Arlequin. — Il est bien décidé à le faire...
Colombine. — Hélas ! oui !.. le pauvre garçon!
Arlequin. — Ça serait une admirable solution.
Colombine. — Tais-toi, monstre, tais-toi!
Arlequin. — Ah! si j'avais quelque cordon à lui prêter.
Pierrot.— Hélas! hélas !... Jusqu'à mon dernier
souffle ce monde se montrera terrible pour moi. Il m'a refusé du pain pour vivre, il me refuse un peu de chanvre pour mourir...
Colombine. — Pauvre Pierrot!...
Arlequin. — Ah! si j'avais quelque corde à lui passer. (Il se fouille.) Non, rien ! rien !... pas le plus petit bout de ficelle! rien! rien ! Ah ! c'est désolant !... On devrait toujours avoir une corde sur soi ! C'est désolant, désolant !... Une occasion unique...
Colombine. — Tu n'as donc pas de cœur, Arlequin?... Vois, moi, je suis tout en larmes !... (Elle sanglote).
Pierrot. — Oui, comme l'a dit le poète, du temps où il y avait encore des poètes, je suis, ici-bas, le cygne harmonieux et candide qui, méprisant les premiers frissons de l'hiver, a dédaigné de s'envoler vers les climats bienveillants. L'eau du lac s'est gelée. Mes ailes blanches sont prises dans les glaces, et mon col flexible et ma tête harmonieuse et mon œil douloureux se tendent vainement vers l'éther qui les appelle !... Ah! si j'avais une corde, rien qu'une corde !...
Arlequin (ému). — Pauvre Pierrot !...
Pierrot. — Mes ailes irrémédiablement soudées aux glaces d'ici-bas saignent par toutes leurs pennes !... Hélas ! Hélas !.. (Il pleure.)
Arlequin. — Il m'attendrit !... Tu avais raison, blonde Colombine, je n'avais pas de cœur, pour n'être point ému par cette éloquence désespérée, par ces larmes !... Pauvre Pierrot ! Pauvre Pierrot !... Ah ! Colombine, tu avais raison !... Mon discours était infâme! Il faut sauver ce malheureux... Oh! femme! ange de pitié et de charité !...
Colombine. — Dis-moi, Arlequin ?. . .
Arlequin. — Colombine?
Colombine;. — J'ai bien. . J'ai bien la cordelière de mon manteau ?... Si nous la lui jetions?...
Arlequin (stupéfait). — Quoi?... La cordelière de ton manteau ? Tu veux lui jeter la cordelière de ton manteau ?...
Colombine. — Oh !... C'est très solide... C'est en soie.
Arlequin. — En soie !...
Colombine. — Oui.
Arlequin. — Oh ! femme! femme !..
(Colombine s'avance sans être vue de Pierrot et dépose à ses pieds la cordelière en question.)
Colombine. — Pourvu qu'il l'aperçoive.
Pierrot. — Oh! Lune! Lune !... Sois pitoyable une fois !.. Envoie-moi tout ce qu'il faut pour me pendre.(Il aperçoit la cordelière.) Tiens!... Un cordon, un cordon de soie... C'est solide... C'est tout ce qu'il faut...
Colombine. — Bravo! bravo !... Il la tient...
Arlequin.— Pauvre Pierrot!...
Pierrot. — Mais d'où diable peut provenir ce lacet secourable ?... (Il regarde de tous côtés.) Personne !.. Personne !... Quelle bienveillante divinité?... Serait-ce toi, ô Lune, ô ma blonde maîtresse ? Aurais-tu enfin pris une fois pitié ? Oh! laisse-moi le croire. Eh ! d'ailleurs, qu'importe?
Colombine. — Pourvu qu'il ose, maintenant.
Pierrot. — Qu'importe? Qu'importe? Je veux monter vers toi! Je veux voler vers toi... Ce sapin... (Il monte sur un sapin.) Je sors sans regret « d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve ». Et maintenant, glaces d'ici-bas qui reteniez mes plumes prisonnières, adieu... Je monte, je vole, à travers l'éther bleu, vers les blonds cheveux de ma douce Lune, dans le beau pays où l'on a le droit de chanter, je vole, je m'envole, adieu, ah! (Il se pend.)
Arlequin. — Ah ! le malheureux ! le malheureux!
Colombine. — Bravo !... Je ne l'aurais pas cru si brave...
Arlequin. — Le malheureux ! Si je montais couper la corde ...
Colombine. — Non, allons chercher la gendarmerie.
Arlequin. —Oui, courons!
Colombine. — Attends !... Crois-tu qu'il soit bien mort?...
Arlequin. — Il tire une langue d'une coudée et ses yeux pendent hors de ses orbites... Il est bien mort, hélas!... le pauvre garçon!
Colombine. — Alors, cours appeler à la garde. (Elle défait son chignon, s'accroupit sous le pendu la tête dans les mains, et se met à sangloter, en s'arrachant les cheveux.) Hélas! hélas!... ah! ah ! ah!... Pauvre Pierrot ! Pauvre Pierrot !... Ah !... ah !...
Arlequin (dans le lointain.) — A la garde! à la garde!
Colombine (toujours sanglotant). — Ah! ah! mon pauvre mari ! hi ! hi ! hi !... Il s'est pendu ! hu ! hu ! hu !...
M. Barbin. — Pauvre femme! Sa douleur est bien légitime.
Colombine. — Ah ! ah!... J'en deviendrai folle! folle!
Polichinelle. — Place à la force publique! place!
Arlequin. — Comment, vous, Polichinelle! Vous êtes gendarme, maintenant?
Polichinelle. — Eh ! oui, mon ami, gendarme! brigadier de gendarmerie... Je me faisais vieux... J'en avais assez de rosser les gendarmes!... Les temps où nous vivons ne permettent plus la fantaisie ni la poésie de la vie de bohème... J'ai fait comme vous, je me suis rangé ; et, comme j'étais un habile gredin, je me suis dit que je serais un habile gendarme! Mais, place ! place ! Quand un pendu s'est pendu, la théorie dit qu'il faut tout d'abord le dépendre: dépendons-le...
Colombine. — Ah! Ah ! Mon pauvre Pierrot ! mon pauvre Pierrot ! Oh! oh ! oh!..;
M. Barbin. — C'était un grand poète, Madame, un grand poète .. Je comprends votre douleur... J'étais justement en pourparlers avec lui pour l'achat
d'un volume de vers. J'en offre cent mille livres, Madame, cent mille livres.
Colombine. — Cent mille livres !... Ah! pauvre Pierrot! oh! oh !...
Polichinelle. — C'est pour rien.
Un homme. — On trouve peu de génies comme le sien.
Un autre. — Ah ! certes, son nom sera immortel!
Un autre. — Il faudra lui élever une statue!
Un autre. — Je m'inscris pour mille francs sur la liste de souscription!
Un autre. — Je veux interpeller la Chambre pour que l'Etat lui fasse des funérailles publiques!
Arlequin. — Je ferai son éloge à la prochaine séance de l'Académie, et je dirai ce qu'on a dit de Molière: Rien ne manque à sa gloire... Je parlerai sur sa tombe!
Colombine. — Hélas ! ah! ah ! ah ! mon pauvre mari !... mon pauvre mari !...
Tous. — Pauvre Pierrot! Malheureux Pierrot!
M. Barbin. — Je veux faire de ses œuvres une édition nationale. Arlequin, Pierrot était votre ami, consolez sa femme, éloignez-la de ce lieu sinistre!
Arlequin. — Viens, Colombine. (Il l'entraîne.)
Colombine. — Si l'Etat prenait les funérailles à sa charge, ce nous serait une sérieuse économie.
G.-Albert Aurier.
(1) Pièce en un acte complètement charpentée, mais non écrite : Albert Aurier avait l'intention de la mettre en vers, ainsi qu'en témoigne le fragment que nous publions plus loin en note. — A. V.
(2) Nous avons trouvé dans les papiers d'Albert Aurier un fragment du monologue de Pierrot mis en vers. Le voici:
- Tiens ! la Lune!... Bel astre au rire de corail,
- Oh ! Dis-moi, douce Lune, es-tu le soupirail
- De ce navrant caveau de boue et de ténèbres
- Où nous vivons nos riens grotesques et funèbres ?...
- Es-tu le soupirail ouvrant sur l'Infini,
- L'indulgent soupirail, radieux et béni,
- Qui laisse ruisseler jusqu'en nos noirs cloaques
- L'or des rayons divins et paradisiaques?...
- O soupirail, Espoir des poètes maudits,
- Lucarne qu'illumine un peu de paradis,
- O mystique lucarne aux flamboiements étranges
- Qui nous fais entrevoir le blond pays des anges,
- Lune, cher réconfort du mortel voyageur,
- Que j'aimerais, donnant, ainsi qu'un bon nageur,
- Un fort coup de talon aux limons de la terre,
- Monter dans les flots bleus vers l'éternel mystère,
- Monter, monter parmi les océans d'azur,
- Et traverser ton orbe éblouissant et pur !...
- Cœur joyeux bondissant vers la Splendeur première,
- Que j aimerais crever ton disque de lumière
- Ainsi qu'un clown de cirque, en son grotesque saut,
- Crève le papier d'or d'un rutilant cerceau!...
- Mais, dans ce monde bête où l'aveugle Fortune
- Me jeta par erreur, faire un trou dans la Lune
- Est scandaleux, qu'on soit poète ou financier.
- Eh! oui, qu'on soit artiste ou qu'on soit épicier,
- II faut faire son trou comme le stercoraire !...
- C'est la mode du lieu!... Et, d'ailleurs, ce libraire,
- Je crois, avait raison!... Son dire était exact!...
- C'est un homme sensé, plein d'esprit et de tact,
- Un bon garçon un peu coquin, mais très honnête;
- En somme, un brave, grave et sage proxénète '...
- Ce bon Monsieur Barbin, sans doute, avait raison
- De t'offrir, ô Pierrot, de faire en sa maison,
- Qu'encombrent les talents reliés en basane,
- Le doux et lucratif métier de courtisane!
- Ah ! la belle façon de comprendre notre art !...
- On fait la fille! On va sur le grand boulevard,
- Exhibant des mollets et dardant des œillades
- Pour raccrocher les vieux quêteurs de rigolades.
- Eh ! quoi ? Comment? Pierrot, tu dédaignes l'argent
- Que t'offre un homme honnête et fort intelligent
- Pour brocanter la chair de ton rêve et te vendre?...
- — Me vendre! Serviteur !... J'aimerais mieux me pendre.
- J'ignore l'art de maquiller mes pauvres vers
- Au goût des amateurs quelconques et divers,
- De faire le trottoir ou même la fenêtre !...
- — Me pendre?... J'y serai bientôt forcé, peut-être !...
- Car que fais-je, en somme, ici-bas? En vérité,
- C'est par distraction que les Dieux m'ont jeté,
- Pauvre aiglon envolé, sans plumes, de son aire,
- Dans ce monde grotesque où je n'avais que faire,
- Sur cet astre boueux, parmi ces vils marchands
- Dont j'ignore la langue et qui raillent mes chants.
- — Ah! mes illusions!...Chères fleurs bien fanées !...
- Hélas ! Pauvre Pierrot, voici quaranteftmnées
- Que tu traînes tes fers au bagne d'ici-bas !...
- Les huissiers ont vendu ta guitare et tes bas,
- Le boulanger n'a plus pour toi pain ni farine,
- Ton front pâle et fripe de rides se burine!...
- Où sont tes gestes fous et tes jarrets nerveux?...
- Il a neigé parmi la nuit de tes cheveux !...
- Qui se souvient encor de ta mine replète ?...
- Te voila plus étique et plus sec qu'un squelette,
- Et ce blanc vêtement, pur tissu de candeur,
- Qui, jadis, te faisait plus fier qu'un commandeur,
- N'est plus sur ton échine avachie et piteuse
- Qu'une loque sordide et bien calamiteuse !...
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour guérir le poète Julien Leclercq de sa maladive sentimentalité.
Il y avait une fois une jeune fille qui s'appelait Aveline. Elle était si belle et si douce avec ses grands yeux couleur de myosotis, ses chairs pâles comme du lait et ses longs cheveux presque blancs, que les garçons du pays, qui n'étaient pourtant point des poètes, la prenaient tous pour un ange qui avait perdu le chemin du Paradis.
Un jour qu'Aveline, en robe blanche, et ses cheveux presque blancs flottant sur ses épaules se promenait dans le jardin occupée à cueillir des lys, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, par hasard, était venu se promener dans ce royaume, vint à passer sur la route et aperçut, par-dessus la haie d'aubépines en fleurs, la belle et douce jeune fille, toute blanche, parmi les lys du jardin.
Il s'arrêta pour la contempler , et comme, à ce moment, un garçon du pays passait sur la route, il lui demanda quelle était cette si belle et si douce jeune fille aux grands yeux couleur de myosotis, aux chairs pâles comme du lait, aux longs cheveux presque blancs.
— Seigneur, répondit le garçon du pays, elle s'appelle Aveline, mais, sans doute, ce n'est point une jeune fille, c'est un ange qui a perdu le chemin du Paradis.
Notre-Seigneur Jésus-Christ s'éloigna, tout songeur, et ne tarda point à remonter dans le ciel. Il alla trouver son père, qui était assis sur un trône d'or et qui caressait sa longue barbe blanche, en
écoutant les sublimes chansons que chantaient les chœurs des chérubins.
— Mon père, j'ai vu sur la terre une jeune fille qui s'appelle Aveline. Elle est si belle et si douce, avec ses grands yeux couleur de myosotis, ses chairs pâles comme du lait et ses longs cheveux presque blancs, que les garçons du pays, qui ne sont pourtant point des poètes, la prennent tous pour un ange qui a perdu le chemin du Paradis... Mon père, elle était toute blanche parmi les lys du jardin, et moi aussi je crois que ce n'est point une jeune fille, mais un ange qui a perdu le chemin du Paradis.... Pourquoi, mon père, puisqu'elle en est digne, ne lui ouvririons-nous pas le ciel, et ne lui donnerions-nous point pour compagnons les anges qui sont ses frères ?...
— Comme il vous plaira, mon fils, mais j'ai peur qu'il en résulte des choses fâcheuses, car en définitive les femmes ne sont point des anges.
— Ah! mon père, si vous l'aviez vue, toute blanche, parmi les lys de son jardin !....
— Enfin, mon fils, essayez.
Notre-Seigneur Jésus-Christ redescendit du ciel dans le pays qu'habitait Aveline.
Elle était dans sa chaumière à réunir en bouquet les lys qu'elle avait cueillis, et elle en avait mis quelques-uns dans ses cheveux presque blancs.
— Aveline, lui dit-il, vous n'êtes point une jeune fille, vous êtes un ange qui a perdu le chemin du Paradis.
— Seigneur, dit-elle simplement, tous me le répètent, mais vraiment je n'en sais rien.
— Aveline, suivez-moi, je vous ouvrirai la porte du ciel, où, sans doute, vous êtes née, et je vous rendrai la compagnie des anges qui sont vos. frères.
Ils partirent ensemble, et Notre-Seigneur Jésus-Christ remonta au ciel en l'emportant dans ses bras.
Elle ne fut point du tout dépaysée. Tout le jour, elle s'amusa à marcher dans l'azur, à se coucher sur les beaux nuages, à écouter les divines musiques des chérubins, à parler avec les anges.... Tous la regardaient courir dans les célestes pourpris, si belle et si douce avec ses yeux couleur de myosotis, ses chairs pâles comme du lait, et ses longs cheveux presque blancs étoiles de fleurs de lys, et tous se demandaient quel était cet ange qu'ils n'avaient encore jamais vu dans le Paradis.
Avec eux, elle chantait de sa voix si douce et si pure les louanges du Très-Haut, avec eux elle buvait dans des coupes d'or le rose nectar, qui est, comme tout le monde sait, le vin délicieux que donnent les treilles qui poussent dans le ciel.
— N'avais-je point raison, mon père, disait Notre-Seigneur, Aveline n'était-elle point faite pour vivre parmi nos célestes phalanges?
— Mon fils, attendons la fin... J'ai peur que de tout cela il ne résulte rien de bon...
Et, assis sur son trône d'or, le Très-Haut se mit à caresser sa longue barbe d'argent, n'écoutant plus que d'une oreille distraite les sublimes chansons que chantaient les chœurs des chérubins.
Cependant, il y avait déjà un jour, tout un jour qu'Aveline avait pénétré dans le Paradis, qu'Aveline savourait les voluptés ineffables du Paradis. Etait-elle donc déjà lasse des célestes félicités? Elle ne jouait plus avec les anges, elle ne chantait plus avec eux de sa voix si douce et si pure les louanges du Très-Haut. Elle semblait inquiète. Une imperceptible crispation altérait le calme de son visage pâle, et parfois elle mordillait nerveusement ses lèvres... Elle marchait comme anxieuse dans l'azur, elle faisait le tour de chaque nuage et semblait impatientée de trouver partout
des anges, des archanges et des chérubins, jouant ou chantant... Ceux-ci la regardaient étonnés, car ils n'avaient jamais vu pareilles expressions sur des visages... Enfin, comme dans un coup de désespoir, elle arrêta l'un d'eux par sa robe d'azur, et, se penchant à son oreille, elle se mit à lui parler tout bas. Il parut très étonné et il répondit:
— Mais, je ne sais pas, je ne vous comprends pas...
Et comme elle insistait, il ne put que répéter:
— Je ne vous comprends pas.... Je ne sais point ce que vous voulez dire... Je n'ai jamais entendu parler de cela.
Et il appela d'autres anges et d'autres archanges et d'autres chérubins, et il leur répéta les paroles d'Aveline, mais tous parurent aussi étonnés que lui et tous dirent:
— Nous ne savons pas... Nous ne comprenons point... Nous n'avons jamais entendu parler de cela.
Alors Aveline s'éloigna et se mit à pleurer. Mais tous la regardaient, car ils n'avaient jamais vu pleurer dans le Paradis.
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui était assis à la droite de son père, l'aperçut tout en larmes, et il lui fit signe d'approcher:
— Eh ! quoi? lui dit-il, vous pleurez, Aveline? Vous pleurez dans le Paradis? Qu'avez-vous donc, Aveline ?...
— Seigneur, dit-elle, c'est sans doute le nectar, tout le nectar que j'ai bu... et les anges n'ont pas voulu me dire...
Elle s'interrompit pour éclater en sanglots, et comme Notre-Seigneur Jésus-Christ ne comprenait point encore, elle fut obligée de se pencher à son oreille et de lui dire tout bas, en rougissant, ce qu'elle avait dit aux anges.
— Aveline ! Aveline ! dit tristement Notre Seigneur, ne pourrez-vous donc point vivre avec nous dans le Paradis... Les anges ignorent ces vils besoins;
ne seriez-vous pas, comme je l'avais cru, semblable aux anges?
— Seigneur, Seigneur, dit Aveline en sanglotant, si je ne puis me soulager dans le Paradis, il faut que je le quitte, il faut que je le quitte. De grâce, transportez-moi sur la terre, dans mon petit jardin où fleurissent des lys... car vraiment je ne puis plus attendre, je ne puis plus attendre.
Aveline est revenue sur la terre. Elle se promène encore, toute blanche, parmi les lys du jardin, et les garçons du pays, qui pourtant ne sont point des poètes, lorsqu'ils l'aperçoivent si belle et si douce, ses grands yeux couleur de myosotis, ses chairs pâles comme du lait et ses longs cheveux presque blancs, par-dessus la haie d'aubépines en fleurs, ne manquent jamais de [la prendre] (1) pour un ange qui a perdu le chemin du Paradis.
Et tous les poètes aussi, qui sont venus de villes lointaines jusqu'où vola la réputation de sa céleste beauté, lorsqu'ils l'aperçoivent si belle et si douce, avec ses grands yeux couleur de myosotis, ses chairs pâles comme du lait et ses longs cheveux presque blancs, par-dessus la haie d'aubépines en fleurs, occupée à cueillir des lys dans le jardin, ne manquent jamais de lui dire, en leurs jolies chansons, qu'elle est un ange qui a perdu le chemin du Paradis.
Mais elle se contente de les regarder avec un sourire mystérieux, car elle sait bien maintenant qu'elle n'est point un ange, point du tout un ange!
6 juillet 91.
G.-Albert Aurier.
(1) Ces deux mots manquent sur le manuscrit. — A. V.
Salomé (1). — Meretrix suadet, puella saltat, sanctus decollatur, — telle en un verset de vieille séquence l'histoire de la mort du Précurseur. Une légende allemande rapportée au Xe siècle dans les Praeloquia de Rathier de Vérone, puis dans le poème latin du Renard, composé en Flandre (Rheinardus, I, 1145 et suiv.), donne une autre cause immédiate à cette décollation préfigurative : Hérodiade, fille d'Hérode, aimait Jean-Baptiste, le voulait, ne voulait que lui,
- Hacc virgo, thalamos Baptistac solius ardens,
- Voverat, hoc dempto, nullius esse viri.
Hérode se fâcha, fit supplicier le prêcheur qui avait ensorcelé sa fille. Hérodiade prit entre ses mains la tête coupée et approcha des lèvres mortes ses lèvres avides ; les lèvres mortes se rouvrirent pour un souffle d'horreur, et la pucelle au terrible amour disparut dans l'espace, — où elle voyagera jusqu'à la fin du monde, symbole des passions sacrilèges.
La Salomé du frère prêcheur florentin ne ressemble guère ni à la voluptueuse et savante danseuse, ni à la violente amoureuse: en sa robe de lilas très pâle, elle est chaste comme l'imagination du pur moine; son air est un peu méchant et un peu ennuyé, comme d'une qui fait son métier et non pas son plaisir; blonde décolorée par les essences, elle se lève légère et adroite, dessine en son vol de beaux plis symétriques, mais laisse à peine voir la forme de son pied vêtu de pourpre.
Cependant, dehors, le Saint pose sur le billot sa tête de Géant, de précurseur du Géant de la double Substance; elle roule et un valet l'apporte en la salle du festin,où rêve, attablé avec ses officiers, le Tétrarque couronné d'or.
Et Salomé danse toujours, toujours, — puisque c'est son métier de femme.
L'Imagier.
(1) La mort de S. Jean-Baptiste de Beato Fra Giovanni de Fiesole detto l'Angelico (Au Louvre, Primitifs italiens, n° 1291.)
Haerès, par Léon-Alphonse Daudet (Charpentier).— « La meilleure formule de lecture serait, selon nous, celle-ci: apprendre en s'émouvant. » Ainsi M. Léon-Alphonse Daudet renseigne sur son esthétique les historiens à venir de la littérature française, où il ne manquera point de laisser, ainsi que son père, de notables souvenirs. Cette déclaration loyale n'est point sans quelque péril: ne se trouvera-t-il pas de malicieux critiques pour rapprocher aussitôt d'fiaerès les VoyagesExtraordinaires de M. Jules Verne, les drames de M. Louis Figuier, ou même les Enfances célèbres de Mme Louise Collet, toutes œuvres si estimables en leur genre et qui charmèrent nos jeunes années? Mais qui se permettrait une telle appréciation encourrait peut-être le reproche de légèreté et presque de mauvaise foi; et même, seul, le nom justement célèbre de l'auteur invite à plus de révérence dans la critique. Il est donc décent par provision de tenir pour légitime une forme de roman dont MM. J.-H. Rosny. en presque toute leur œuvre, et François de Nion, dans Lu Peur de laMort, donnèrent d'admirables exemples ; idéalisme scientifique, soit, pourvu qu'en outre nous éprouvions l'émotion promise : sinon, mieux vaudrait relire tout de suite quelques pages de Darwin, ou plutôt, en cette circonstance particulière, le très beau livre, et si attachant, de M. Ribot surL'Héredité psychologique. Voici l'hypothèse que M. L.-A Daudet soumet aux méditations du lecteur : chez certains êtres, les influences héréditaires, au lieu d'être harmonieusement fondues, s'exercent par sautes brusques, déconcertantes, et pendant les périodes diverses de ce développement saccadé l'atavisme d'un ascendant ou d'un collatéral donné l'emporte tyranniquement. Tel Haerès : il est « soumis à l'influence sentimentale de sa mere au début. Dans une deuxième partie, son pere le reprend, le tourne a l'intellectuel. Il se dessèche, s'analyse, devient exclusivement un automate logique, une machin? à penser. Dans une troisième partie, la prédominance de son oncle en fait un débauché satirique. Il meurt au moment de se sentirluimême, cessant d être un tourbillon héréditaire ». Une histoire d'amour peu compliquée sert à illustrer la thèse: Haerès abandonne sans raison, à la veille de l'épouser, une jeune fille dont il a fait sa maîtresse, se donne corps et âme à la science d'abord, puis à la débauche la moins délicate, et, sans raison non plus, revient auprès de la délaissée, qui meurt presque aussitôt; après quoi il se tue. Des personnages secondaires, tels qu'un médecin strictement matérialiste et un bon curé de campagne, reprennent pour leur propre compte différents thèmes qui sollicitèrent l'âme d'Haerès. Sans doute, par un choix discret de comparses conventionnels, M. L -A. Daudet désira éviter à nos intelligences la fatigue Lois (Maurice Barrés); Tripoli d'Occident et Tunis (Paul Radiot); Les Infinis de la Chair (Gaston Danville); L'Ame errante (Paul Brûlat); Stenk.tRa^in (Emile Hinzelin); Crime d'Aïeux (André Godard); Grains de sable (M. Maugeret); Vers et Proses (Stéphane Mallarmé) ; Ballades Russes(Hector Hoornaert); Feuilles au vent (Fernand de Loubens); MonteCarlo (Ernest Kiegler); L'Altiire Confession (William Vogt); Le Koi au Masqued'or (Marcel Schwob'j; La Vie chimerique (Paul Delair); Nouvelles algériennes (Albert Fermé). de.se représenter des images plus inattendues que" l'abbé Constantin, pour que notre attention se reportât, intacte et vigilante, sur le héros principal. Je crains que cette honnêteté littéraire ne soit préjudiciable à l'auteur : il semble bien, en effet, qu'Haerès ne vit pas et n'agit pas une minute; il reste toujours une pure abstraction qui récite sans discontinuer diverses leçons apprises dans les livres. Ni pendant la périmle sentimentale, ni pendant la période de fête, il ne cesse de s'expliquer à la manière des manuels de philosophie, et la pauvre petite amoureuse répète, elle aussi, comme un écho, des phrases empruntées aux penseurs les plus hétérogènes. C'est, tout le long des pages, du Pascal travesti, du Hume défiguré, du Spencer ou du Haeckel retournant à l'enfance. M. I.-A. Daudet paraît, en vérité, confondre l'analyse psychologique avec la réminiscence de textes imprimés, qui se combinent pour lui en aphorismes étranges comme celui-ci: » L'électricité peut bien remplacer le gaz, le vice affecter des marques modernes, les chapeaux changer de forme sur les patères démodées, le fond des êtres est immuable. » Pour être un intellectuel, il ne suffit pas d'avoir lu beaucoup et sans méthode, ni de s'étonner à la vue de musique gravée « que des sons si parfaits à l'oreille soient représentés par une froide série de petits points noirs » : Haerès, en somme, ne se montre guère supérieur à certains chiens savants, qui associent sans peine et sans surprise des idées plus lointaines que celle des notes et celle du son et ne prétendent point pour cela à des connaissances quasi encyclopédiques. Que si maintenant j'essayais de résumer l'impression produite par ce livre, après avoir loué l'heureuse témérité de la tentative, je regretterais qu'il n'y eût point de roman et que le didactisme même soit un peu rudimentaire ; et pour satisfaire au vœu de M. L.-A. Daudet, je tâcherais " d'apprendre » dans les plus récentes études anthropologiques de M L. Manouvrier et de m' « émouvoir », avec M. do Nion , au chapitre des Helminthes, qui demeure un parfait modèle de fiction scientifique. P.O.. James Knsor (avec un dessin d'KxsoR : Mert mystique d'un théologiett}, par EUGÈNE DEMOLDER | Lacomblez, Bruxelles). — Excellente etude du curieux artiste qu'est M. James Ensor, peintre impressionniste, symboliste, naturaliste aussi d'ailleurs, presque toujours bizarre et toujours intéressant. Il était d'autant moins facile de pénétrer cette personnalité complexe que M. James Ensor, peut-être pour montrer son dédain de la critique oiticielle en la déroutant, fut parfais un peu fumiste. Cette étude de M. Dcinolder avait paru d'abord à la Sociéte Nouvelle. Z. Lettres inédites de Jean-Jacques Rousseau, <'•••>•
rcsponii.incc avee M/'ie Boy de -La Tour, publiées par M. la baron HENRI DE ROTHSCHILD fCalmaun Lévyj. — Moins connue, dans le Cercle des amies de Jean-Jacques Rousseau, que la maréchale do Luxembourg ou que Madame de Verdelin, M°10 Boy de La Tour fut pourtant, pour l'auteur de l'Emile, la plus dévouée et la plus utile des amies. De cette petite noblesse bourgeoise de la fin du XVIII° siècle, que n atleiguit guère la Révolution et que la Restauration fit florissante, M°10 Boy de La Tour possédait un sens pratique, une habitude des choses domestiques, qui firent d'elle, joints à son affectueuse prévoyance, une sorte de mère à l'égard de JeanJacques. Et de fait il l'appelle maman tout au long de cette Correspondance, Dans ce recueil inédit, contenant quatrevingt treize lettres conservées jusqu'en 1875 dans la famille Boy de La Tour (Gror^vs-Charles-rerdinand BOY DELATuuu un des derniers descendants, était, un peu avant cette annéo 1815, Directeur de la compagnie d'assurances La Nation-île, à Paris), et qui appartiennent aujourd'hui à la collection d'autographes de M. Henri de Rothschild, il ne faut guère chercher que de l'anecdote, que des détails infinitésimaux de la vie privée du philosophe. Mais ce sont ces détails-là dont on est, àjuste titre, le plus curieux, car ils constituent la substance bien réelle et encore toute palpitante des portraits, souvent déclamatoires et tout en profil, que l'Histoire a consacrés. On y voit que les menus affairements de la vie, que les activités de clocher irritent et excèdent une tète de génie aussi bien qu'une cervelle de commis. Beethoven tenait bien journal des mésaventures ancillaires : « J'ai pris, hier, une nouvelle cuisinière, y consigne-t-il: cuisine médiocre, mauvaise semaine à passer ». Madame Boy de La Tour, autant qu'il fut en son pouvoir, épargna à Rousseau les vexations de la vie courante ; elle lui fut d'une grande ressource durant cette triste période de l'existence de Jean-Jacques qui suit l'apparition orageuse de l'Emile. Mais, au demeurant, elle ne put le préserver contre lui-même, contre l'inquiétude incurable qui le rongeait, ni surtout contre la maritorneThérèse. Ce cœur était bien fermé, et la bonne dame, en sa bienveillance positive, n'était guère apte à le sonder. l'Ile était satisfaite pourvu qu'elle se fût scrupuleusement acquittée des commissions dont incessamment la charge Rousseau dans ces lettres, et à bon compte pour lui, pourvu qu'elle eût envoyé à l'auteur du Devin du village « une épinette jouable, bien en état», et, ensemble, « tout ce qu'il faudrait, cordes, plumes, marteau, écarlate, pour racommoder... ce qui se pourrait déranger », pourvu, aussi, qu'elle lui eût convenablement rassorti les étoffes d,e sa garbe-robe. — On entre dans tous les détails du confort de la haute bourgeoisie du XVIII'siècle, confort clair et moelleux, enguirlandé de toutes les volutes de Trianon, et qui se rectangularisa à travers la Révolution et l'Empire. C'est M°" Boy de La Tour qui s'occupa du fameux costume arménien « dont il importait que 1 étoffe fût de couleur grise et neutre, non de couleur vive que le soleil mange, bon marché, ne se coupant pas, comme on en pourrait trouver d'excellentes occassions dans les rebuts de magasin. — Il faudrait chercher là... Cependant, pour la bordure extérieure et apparente, la fourrure sera plus belle, on mettra soit de la martre à 75 livres ou du petit-gris à 96 livres ». On ne sait, mais ces soins bizarres, chagrins et meticuleuxde Rousseau pour Jean-Jacques font un peu penser au Malade imaginaire, tout confit en la burlesque pharmacopée du XVIIIe siècle. Proscrit et rebuté, Rousseau n'apportait, au surplus, aucune résignation dans la fortune contraire; aucune bonhomie, hélas ! dans sa façon, ou plutôt dans ses façons d'accepter les services d'autrui ; ah ! jamais il ne dit, comme La Fontaine: J'y allais! — Cela le grandit peut-être aujourd'hui, mais déconcerta, à l'époque, bien des gens de son commerce. — M°" Boy de La Tour, exemple presque unique, ne se lassa point de cette laborieuse humeur, de cette perspicacité toujours mal prévenue, souvent mal informée, qui . escomptait, en jouissances personnelles d'orgueil et de hauteur, les ridicules et les défaillances probables d'autrui. E. B. Litanies de la Rosé, par REMY DE GOURMONT (Paris, au Mercure de France et chez Léon Vanier). — Quand le philosophe Secundus ou l'auteur apocryphe à qui l'on a donné ce nom définissait la Lune, en une énumération de mots grecs: Pourpre du ciel, Consolation nocturne, Gardienne toujours éveillée des matelots, Allégement des voyageurs, Vicaire du soleil, Route céleste, EnneTiie des criminels, Signe des fêtes, Mensuelle révolution, Souvenir qui revient sur soi-même, il ne prévoyait point qu'un jour, après des siècles de christianisme, où les vocables accumulés se seraient changés en prière obsédante pour un dieu nouveau, M. Remy de Gourmont détournerait les litanies de leur intention liturgique et ferait chanter à leurs versets redevenus profanes lagloire hypocrite et silencieuse de la Rose. Mais Secundus fut un médiocre écrivain ; il n'aurait point trouvé, âme trop simple et sans art, un aussi riche ruissellement de syllabes sonores. Rarement poète nous versa l'ivresse verbale avec tant de somptueuse prodigalité, et les strophes en prose de M. de Gourmont suscitent dans nos âmes presque délirantes et affolées par des philtres si puissants la vision d'une fête ambiguë, magnifique et cruelle, où tournoieraient sur des tapis faits de chair vivante, parmi les parfums et les drapeaux, des femmes éclaboussées de sang. P. Q_. La Revenue, par MARIUS ANDRE (H. Bernex, Aix). Je croyais pourtant ses cheveu* bien lointains Et bien lointaine Si i robe, Depuis qu'elle ,r pris le chemin Des Jeunes printemps ci des Jeunes matins En me laissant dans la foret d'automne. Voici ses cheveux, pourtant, et sa robe... Mais les dix pages de ce petit poème, curieux en sa mièvrerie, ne sontpoint sur ce ton. Les vers libres de M. Mnrius André font penser d'abord au mot de Verlaine: — De mon temps on appelait ça de la prose — (et dela prose bien décousue, faudrait-il ajouter). Circonstance plus désastreuse, LaRevenue se termine par une scie de café-concert: Quel mâle t'appelle? — Tant pis pour moi! — Pour quelle étreinte? — Tant pis pour toi! — Devant te vitrail de la chapelle Je tu' ploierai plus les genoux — Tant pis pour nous! — Bien qu'il soit toujours désagréable de passer pour un donneur de conseils, si M. Marius André nous « chante » les Gestes attendris qu'il annonce, je ne saurais trop engager sa famille à surveiller ses accointances. Pour user de son ramage: Oïl en nitiirl. parfois, savcs-vons! C. Mki. La Leçon d'Amour, par PAUL FRANCK (au Masc.irillc}. — Un bon petit jeune homme, qui pourrait, comme saintjoseph, porter un lis à la main, étudie l'amour dans un alphabet qui s'appelle Mademoiselle Irma. Toute la gamme des gestes permis, car il s'agit (heureusement, mon Dieu ! ) d'une pantomime vive et animée. A la fin, Mademoiselle Irma ayant joint la chartreuse aux gestes, le bon petit Pierre s'endort bercé par des vers un peu plus convenables que le sujet, mais il se réveille sous le rideau, sans doute à cause de la charmante musique du collaborateur, Mlle Maguéra. Tout ça, c'est délicieux; seulement, une question: comment indiquet-on, dans une pantomime, qu'une jeune personne s'appelle Irma?
- .
Le Vœu de vivre (II), par RENÉ Gmi. (aux Ecrits pour l'Art). — On sait que le Dire du Mieux, première des trois parties qui composent Œuvre, se subdivise en'sinq périodes. Le Vœu de vivre est le deuxième livre de la quatrième période. Z. Bobiu, par FERNAND BAVDOUX (Savine). — C'est la troisième histoire de cirque parue ce mois-ci!... (Que de papier crevé, mon Dieu !; Ecrite,d'ailleurs, avec soin,cette dernière, on avant-dernière, je ne sais trop,est de beaucoup la meilleure. Détails techniques sur la dislocation de Messieurs les forains, amours brutales à la cravache, pauvre pitre souffre-douleur, bateleur marseillais, rien n'y manque, pas même la mort théatrale de la fin, qu'on prévoit dès le commencement, et qui losionne dans le decor de paillons toujours pareil, mais "fait toujours tantde plaisir, Bobin est une œuvre naturaqu1 fort soigneusement exécutée. La seule chose un peu choquante, mi point île vuo du seul naturalisme s'entend, est la virginité dudit saltimbanque Bobin,bien improbable, malgré son amour de cu;ur, dans un pareil milieu.
- -•
Rimes et Rythmes, par LAGODEY (La Rochelle, Noe'l Texier). — Le poète, explique M. Legodey, « est le confident des roses qui lui content leur émoi ». Comme une k.irpe e'ohenut A tous les souftlfs vibrant. L'âme Jollt qu'est l,i sienne Vit ffia.qut heure se livrant. En effet, l'erreur de» esprits point suffisamment subtils, en ce temps oules rimailleurs pullulent,estsurtout de croire que lo principal rôle de la poésie consiste à traduire des impressions immédiates. Tel s'apitoie sur un nrbre, bavarde sur la couleur des prés, les petits oiseaux, le tapage de l'océan; un autre chante les maîtresses qu'il n'eut jamais et décrit avec l'emphase d'un triomphateur l'illusoire possession de leur jeunesse; un troisième s'arrête sur le trottoir, note la grimace d'un passant,le « coup de lumière » sur l'ombrelle d'une dame, rêve à la bizarrerie des destins en contemplant un guenilleux. Suivant la fécondité de l'auteur, cela fait trois cents pages ou une brochure,et pour peu que le vers soit correct,nous avons un grand homme de plus sur l'étagère. Quant à s'inquiéter de la signification des choses.à chercher plus loin que l'extériorité, à grouper au moins, en vue d'une certaine impression d'art, les notations épurses dans le fatras ordinaire d'un bouquin de poésies, c'est lu souci d'une si piètre minorité qu'on peut presque certifier qu'il n'existe point. Trois ou quàtre idées la philosophie des jeunes poètes depuis cinquante ans; rien ne prouve qu'ils desirent en changer; mais le mi banales sont la pi racle, quand même, c'est qu'on puisse les utiliser encore. M. Lagodcy (!),qui me suggère ces réflexions d'ailleurs pas. neuves, écrit, comme les camarades, pour une femme de ses amies; il parle sur le Printemps, sur les Blés, les Nuages, la Mer, les amourettes elles tristessesde la passion. Cependant sonvers est joli,musical sauvent (la strophe cit6e plus haut est d'une pièce fort inférieure), et, par cela mémo qu'il semble comprendre plus volontiers que la troupeau, il aurait tortje pense.de s'en.tenir là. — Lorsqu'enfin il déclare en fermant sa brochure: «Nous avons dignement accompli notre tâche», —je le dis en toute franchise, il est certain qu'il se trompe. C. Mki. Etoile de Cirque, par ARUAND DuiiABRY(Simonis Kmpis). — Huit tètes, dont une de lion, regardent sur la couverture une jeune femme qui tient une cravache. A l'intérieur de la ménagerie, c'est moins drôle; par exemple, il y a une niarquise courant après son hls pour l'empêcher d'épouser sa dompteuse et qui est particulièrement exaspérante. A la fin, on découvre que ladite dompteuse est la fille naturelle de cette marâtre, et l'union incestueuse ne s'accomplit pas parce que cette petite dinde de Zingarclle recule devant un bien vieux préjugé. Puis ça se termine dans une phrase dont le simple énoncé dira,je crois, tout l'interêt du livre: « L'égoïsme, en rétrécissant les cœurs, étouffe et sèche la pitié dans ceux-ci. « Annuaire de l'Association Générale des Etudiants de Paris, 1892-1893. — Vient de paraître au siège de l'Association, 41-43, rue des Ecoles. RÉIMPRESSIONS Les Miens : I. Villiers de l'Isle-Adam, par STÉPHANE MALLARMÉ, avec portrait de Villiers de l'Isle-Adam gravé par MARCELLE» DESBOUTW (Bruxelles, Lacomblez). — CTest, dans la jolie collection de l'éditeur LacomMez, la conférence du maître, dite «six soirées en Belgique, dont deux à Bruxelles, puis Anvers, Gand, Liège et Bruges, et une a Paris, avec un auditoire privé, dans le salon de Madame Eugène Manet». Il serait oiseux ici d'analyser cette remarquable et pieuse causerie de M. Stéphane Mallarmé sur Villiers de l'IsleAdam: elle est dans toutes les mémoires. A. V. Le Salariat ; La Loi et l'Autorité, par PPBRRE KROFOTKINE (Bureaux de la Révolte, 140, rue Mouffetard). — Deux brochures. La Loi et l'Autorité surtout est très importante; on y trouvera une analyse sagace de l'idée de loi et cette conclusion incontestable que la Loi et l'Autorité ont « développé les instincts de cruauté dans l'homme, instincts inconnus même aux singes, l'homme étant devenu l'animal le plus cruel de la création ». p. a
(1) Aux prochaines livraisons : Inséparables (Jeanne Mairet); Lilith (Remy de Gourmont) ; En Bretagne (Auguste Barrau); L'Aube (Adolphe Tabarant); Les Noces de Sathan (Jules Bois); Contes sur Porcelaine (Jean Madeline); Promesses (Jules Case) ; Les Amants de Taillemark (Maurice Desombiaux); Le Traité de la Méduse (Maurice Quillol) ; Les Heures de Dom Noël Mars (Pierre Dufay); Un Cœur discret (Gustave Guiches); Typhonia (Josephin Péladan); Les Cœurs utiles (Paul Adam); La Lutte meilleure (D. Maysonnier); L'Ennemi des
JOURNAUX ET REVUES
Au Nieuwe Guis d'oct >bre: Plttoniscke Studién et la fin de Anaxagoras of oser de Smart, du Dr Ch. van Dcventer : les dialogues que le NieuweGids publie de M. Van Deventer sont une imitation très réussie des dialogues de Platon; ils ont sans duute pou de lecteurs, mais n en valent pas moins. — Fragment utt Jotaanes Vialar. extrait d'un roman psychologique que M- Frederik van Eedon, un écrivain délicat et charmant, va bientôt faire paraître. — Geneeskundigf Armell\org, par G. \V. Bruinsma. — De Frans Erens, quatre poèmes en prose: Pijp\ Proviucie\ Amstelveld \ Frisclt,— Nederliudsche Poliliek, par P. L. Tak. — Ziekt Prias, par Delang. — Nederlandsfhe Bourgeoisie, par F. v;>n der Goes. — Sfmflffl et quelques fragments traduits d'Eschyle, par M. H. J. Boeken, dont le talent, non peut-être des plu» robustes, est d'une remarquable élégance. — Enfin, signées J. C. M.,
., des impressions nées de la lecture de Péllèas et Mêlisandf et de 1 Ecornifleur.
Rouen-Artiste (n° 72) publie ces deux poésies inédites de Louis Bouilhet:
I
Regarde: en s'enfuyant, toute barque apres elle
Laisse aux flots un sillon;
La fleur laisse un parfum—l'oiseau laisse un bruit d'aile.
L'étoile un blanc rayon!
Tout laisse quelque chose, 6 ma vierge bénie,
En passant tour à tour;
La priere un espoir — la lyre une harmonie,
Et ton regard, l ' amour!
Septembre 1843.
II
LE NID
Et la vie est comme une tente
Où l'on dort avant le combat.
VICTOS HUGO.
Enfant, jette lesyeux au haut de cette cime:
Vois-tu ce nid d oiseau qui penche sur l'abimt
Avec ses cris, sa joie et son bonheur charmant?
Parfois, quand le vent gronde et quand la foudre brille
On voit ie nid1 qui tremble, et toute la famille
Flotter sur le gouffre écumant.
Ainsi, l'homme, ici-bas, caché sauf un mystere,
Dans cet immense nid qu'on appelle la terre,
Déposant ses amours, son cœur, sa volupté,
— Par un bras tout-puissant, suspendu dans Fespace
Tremble et flotte au hasard, à chaque tent qui fasse,
Sur les bords de l'éternite'!
Juillet 1840.
Alors qu'on se préoccupe tant de l'orientation des jeunes, et que les journaux essaient de se renseigner en questionnant tout le monde, grands hommes et débutants, voici, à ce que rapporte M. Léon Riotor dans le Journal, que le docteur Lacassagne, de la Faculté de Lyon, prétend résoudre scientifiquement la question par une enquête sur le cerveau littéraire: « Des faits, des actes, de la pathologie, le fonctionnement de la machine, la parturition de l'Idée dans sa matrice origi. nelle, et de cela déduire un ensemble, une opinion, une.«réalisation» . Cette enquête doit être vaste, innombrable, accepter les opinions les plus infimes... Les faits physiologiques porteront surtout sur les sens du cerveau, la vue, l'odorat, l'ouïe, et dans le domaine psychique sur les différents modes d'idcation... Aussi Lacassagne a-t-il baptisé son enquête: Recherches statistiques sur lesrelations entre l'intégrité des appareils sensoriels, la qualité de la mémoire et le mode de fonctionnement tics centres du langage et de f'idéation.a
A, Y •
La Grande Revue publie un roman de Boyer d'Agen, Terre ue Lourdes, étude de mœurs locales et de psychologie religieuse. En telle page est citée la divine chanson populaire dont le refrain est:
Va, mon ami, va, la lune se leve.
Va, mon ami, va, la lune s'en va.
Cette chanson (dont l'air est un frisson d'amour) est connue dans toute la France : on l'a recueillie dans la haute Bretagne.
Lire dans le même recueil les études mensuelles de A. Lacuzon sur la Littérature évolutive : elles sont fort intéressantes.
R. G.
CHOSES D'ART
Expositions.
Renouvellement de l'exposition chez LE BARC DE BOUTTBVIU.E. Des œuvres inédites, mais pas d'artistes inédits, — sauf Iker, qui se manifeste avec de doux crépuscules, de fines nuits bleues : cet artistes, nous affirme-t-on, un talent très original ; ce qu'il nous montre là n'est qu'intéressant.
Parmi les peintres déjà connus nous avons noté les ^nvois de:
Maurice Denis : des études d'une précieuse hardiesse et un chef-d'œuvre de pureté et d'expression, une jeune femme i mi-corps, dormant la tète penchee et appuyée sur le bras. Plus varié que la plupart, M. Denis s'affirme très fécond et très maître de soi;
Chéret : une fantaisie;
Séruzier : des Bretons priant devant la chasse d'un saint; bonne composition très expressive;
Anquetin: portrait de Zo d'Ajca;
Giran-Max :joli paysage en bleu;
Mme J. Jacquemin : série de dix pastels toussinistrement curieux, d'une spiritualité exaspérée et malade ; le pâle violet, le bistre las, les jaunes et les blancs mourants dominent en ces œuvres très captivantes;
Bonnard : deux panneaux décoratifs peints sur molleton: un rouge où se tord une femme-tigre; un blanc de nacre très singulier : tout cela est un peu spécieux, — trop japonais;
Ibels : des études un peu en pochade, mais fort vivantes par les attitudes et la couleur;
Guilloux: des couchers de soleil, avec des nuages découpés et collés soigneusement sur des cicux défaillants ; grande habileté, mais qui, au moins, nous donne de neuves impressions visuelles;
Angrand: de grands dessins en clair-obscur : pas de lignes,
le modelé obtenu par dégradation : encore Un procédé, — mVuillard : une quantité de petites études assci diverses ot d'un intérêt évident.
Chez DuRAND-buït, Une série de paysages de Degas, non pas des études, mais des sites heureusement chimériques, recomposés d'imagination, un peu à la manière de Corot.
A Bruxelles, exposition de peinturas selon l'art nouveau, où l'on remarque des envois de Ropç, Trachsel, Filiger, Niederhausern, Fabry, Hannoliau, Hector Thys : beaucoup de choses déjà vues chez les Rose f Croix.
M. Ibcls a fait un très beau et poignant portrait de notre ami Aurier sur son lit de mort. Ce portrait, qui a été lithographié, n'est pas destiné au public : cependant, quelques personnes ayant désiré l'acquérir, M. Ibcls metà leur disposition des exemplaires sur japon, au prix de 5 francs.
M. Roger Marx continue sa croisade contre nos vulgaire* monnaies, timbres-poste, vignettes officielles. Il voudrait d'originales compositions et de belles gravures ! pourquoi pas V
R. G.
Notre ami G.-Albert Aurier avait retouché, remanié et complété, pour en composer un volume qui eût prochainement paru en librairie, les articles de critique d'art publiés ici et ailleurs sur les peintres impressionnistes et symbolistes. Il laisse encore un livre de poésies dont une partie est inédite, et enfin un curieux roman inédit. A ces trois ouvrages seront joints des contes, nouvelles, fragments. Le tout, avec une notice de Remy de Gourmont, formera un gros volume grand in-8° que le Mercure de France met dès aujourd'hui on souscription. Le tirage en est rigoureusement limité à 277 exemplaires, divisés en trois séries:
209 exemplaires beau papier teinté, à 10 fr.
53 — hollande, à........ 20 fr.
15 — Japon , à........... 40 fr.
Une fois close la Souscription, ces prix seront portés à 12, 75 et 50 fr.
Tous les exemplaires contiendront un portrait à l'eau-forte, un autographe d'Albert Aurier, et ceux des dessins reproduits par le clichage. — Les exemplaires hollande contiendront, de plus, des eaux-fortes, lithographies, etc., d’Eugène Carrière, Henry de Groux, Mmc Jeanne Jacquemin, etc., tirées sur japon. — Les exemplaires japon contiendront en outre deux épreuves avant la lettre (chine et hollande) de toutes les eaux-fortes, lithographies, etc.
La note nécrologique parue en tête de notre dernier numéro annonçait comme probable la publication d'un livre d’œuvres posthumes; quelques personnes nous ont immédiatement demandé des renseignements, et nous avons reçu, avant l'ouverture officielle de la souscription, les adhésions suivantes:
Exemplaires japon (à 40 fr.) : MM. Octave Mirbeau, A. Landry, Alexis Joyaux.
Exemplaires hollande (à 20 fr.): MM. François Alicot , Vogel, Remy de Gourmont, Alfred Vallette, Julien Leclercq, Pierre Quillard, Paul Vogler, Roger Marx, A.-Ferdinand Herold, Jules Renard.
Exemplaires papier teinté (à 10 fr.) : MM. Jean Dolent, Maurice Chassang, P.-N. Roinard, Henry de Groux, A. Salmon, Emile Devaulz, Gaston Lesaulx, Laurent Tailhade, Raoul Minhar, Lucien Hubert, Guerlet, Louis Dumur.
Notre confrète Rodolphe Darzens vient de perdre sa mère, décédée le 29 octobre. Nous le prions de trouver ici l'exprcsfiion do nos sympathiques condoléances.
ii London, 10/11/92. a Monsieur,
» M. Raymond Nyst réclamant dans le Mercure de France le titre de Un Prop/iî'te, voulez-vous annoncer qu'avant de rien savoir du livre de M. Nyst ni des romans do MM. Randon et Merrill, j'ai commencé, il y a plus de huit mois,un poème dramatique intitulé Le Prophète?
» Les « idées dans l'air» sont une chose bien ennuyeuse. • Recevez, etc.
« PIBBRB VALIN. » Et de quatre!
C'est le dimanche 27 novembre, à une heure et demie,que sera inauguré dans le jardin du Luxembourg le monument de Théodore de Banville.
La librairie A. Lemerre Vient de mettre en vente un roman de notre collaborateur Gaston Danville: Les Infinis de lu Chiiir — le premier livre d'imagination écrit d'après les données de la psychologie expérimentale.'—Annonçons en même temps que M. Gaston Danville prend la critique dramatique à la Revue Mondaine.
La revue Là Plimie (31, rue Bonaparte) met en souscription une plaquette d'Adolphe Retté : Paradoxe sur l'amour. Eauforte «('Emile H. Meyer. Tirage à 1^4 exemplaires numérotés: 4 ex. sur hollande à grande marge; 150 ex. sur simili-hollande. — Prix : a fr. — // ne sera fuit niservice de presse ni depôt clitf les lihniires. Cette édition ne sera pas réimprimée.
PnUr paraître:
Chez Vanier: Eury,i!tliès, par François Coulon, un essai de drame symbolique dont l'auteur a exposé ici même l'esthétique
(V. livraison d'octobre, p. 117 : ESSIII de Rénovation théâtrale.} Chez Edmond Girard : Prestiges, par Joseph Declareuil.
Au premier dincr des Tètes de Bois, sous la présidence de Jean Dolent : Eugène Carrière, Henrv de Groux, Paul Ranpon, Louis Mettling; les sculpteurs Doublemard et Gustave Deloye ; le dessinateur Job; le graveur Clément Bellenger; puis nos confrères Julien Leclercq, B. Guinaudeau, Emile Besuus, Jules Bois, Auguste Cazalis, André Marty, Paul Dupray, Antonin Bunand, Gaston Lesaulx, etc.
On nous communique cette intéressante note: « M. Mascurt a présenté à l'Académie, de la part de M. Charles Henry, un exemplaire d'un lavis lumineux imprimé en dégradé selon les procedés ordinaires de la typographie par une planche de cuivre avec du sulfure de zinc phosphorescent au lieu d'encre. Après avoir déterminé la loi d'émission et l'intensité lumineuse des différentes teintes, l'auteur a pu résoudre expérimentalement le problème important de la relation mathemathique qui relie à l'intensité lumineuse les numéros d'ordre des différentes teintes. Ces numéros d'ordre ne sont pas autre chose que les degrés successifs de la sensation. M. Charles Henry parvient à représenter les observations par une formule exponentielle, très différente de la célèbre loi psycho-physique de Fechner et qui n'est pas soumise aux mêmes difficultes théoriques. »
Quai Saint-Michel, devant la boutique où vaticinent les muses romanes, Caca-d'Oie, le disciple chéri de Méténier, demande à Pur-Azur, lakiste évancscent:
— « Sais-tu pourquoi Vanier débite à présent des livres de cuisine?
— « Dadais ! exclame l'autre en érigeant un doigt suggestif. Ce sont les dictionnaires latins de Moréas. »
MERCVRE.
tous... Tome VI. P. 102. — LE SALUT PAR LES JUIFS, lig. n, lire :... la. j'oie des Anges... P. 146. — PÏTITS APHORISMES, § 3, lig. 7, lire:... c'est s\i<iner soi-même. P. 149. — IBID., § 27,lig. 4,lire... se consentent des croyances. P. 149. — IUID., § 27, lig. 9, lire : métaphysique... P. 152. — IBID., § 16, lig. a, lire:... sur Salon. Avons-nous rattrapé Solon .<" P. 174. — LES LIVRES, lig. 10, lire : Çocv W